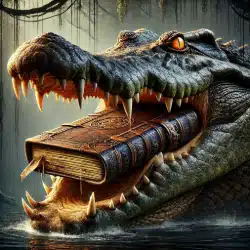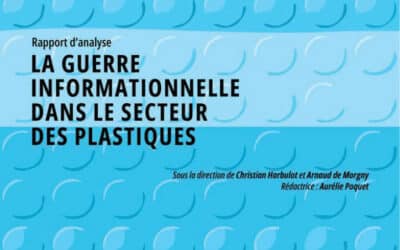Etude du cheminement d’une création de concepts
Années 88-90 : un nouveau type de terrain d’expérimentation
Cette recherche embryonnaire sur la notion de cultures du renseignement débouche sur les prémisses du concept d’intelligence économique. Mais il y eut une étape intermédiaire d’autant plus importante qu’elle coïncida avec des expériences de terrain relativement complémentaires concernant les problématiques de collecte de l’information dans un cadre économique.
L’apprentissage des pratiques allemandes
Dans la seconde partie des années 80, je passe de nouveau de la théorie à la pratique mais un tout autre cadre. L’engagement n’est plus politique mais patriotique. Sans entrer dans les détails, le bilan opérationnel de mon parcours militant des années 70 m’a permis de développer une démarche de renseignement en Tchécoslovaquie avec un ancien camarade de combat de la période maoïste. Le rideau de fer existe toujours. Pour opérer, nous créons une société d’import-export afin de pouvoir justifier des allées et venues entre la France et la Tchécoslovaquie. Ce prétexte nous obligea à chercher des débouchés commerciaux justifiant notre activité sur place. La piste la plus intéressante s’avéra être la miroiterie d’art qui a eu son temps de célébrité dans ce pays entre les deux guerres.
Un artiste tchèque qui travaillait le verre, rencontré à Prague, nous introduisit dans ce milieu. En parallèle, mon associé finit par s’introduire dans le petit commerce local des antiquités militaires. Ce marché noir de la « militaria » est très actif entre les deux blocs. Des gens de l’Est vendaient des objets militaires datant des deux guerres mondiales, qui étaient très prisés par des collectionneurs de l’Ouest, en particulier nord-américains. Les contacts qui résultèrent de ces pérégrinations nous permirent peu à peu d’avoir une idée assez précise des démarches allemandes en matière d’approche indirecte des réalités économiques d’une démocratie populaire.
Ma rencontre avec l’Association pour la Diffusion de l’Information Technologique[1] m’a ouvert d’autres champs d’expérience concernant la problématique de collecte d’informations dans des zones compliquées comme les pays de l’Est à cette époque. Le plus enrichissant fut le dialogue noué avec un étudiant alsacien qui était posté au sein d’une structure d’étude mixte financée conjointement par le Sénat de Berlin et des entreprises ouest-allemandes.
Ce type de structure menait des travaux pour préparer les échanges commerciaux est/ouest de l’après-guerre froide. Les entreprises ouest-allemandes envoyaient régulièrement une documentation sur leurs activités à des entreprises situées de l’autre côté du rideau de fer. Elles créaient ainsi des contacts potentiellement activables en cas de changement de situation géopolitique.
Après la chute du mur, des représentants de ces entreprises ouest-allemandes se mirent à sillonner les anciens pays d’Europe de l’Est pour réaliser un audit technique des entreprises d’Etat afin d’évaluer leur niveau et faire le tri dans les futures transactions commerciales. Il s’agissait là d’une forme de « pointillisme allemand » qui était très différente de l’approche désordonnée que nous constations du côté français. C’était un premier pas dans une démarche d’analyse comparée des techniques de collecte de l’information qui différaient pour des raisons d’ordre stratégique et culturel. Sur le plan stratégique, l’Allemagne de l’Ouest voulait se réimplanter à l’Est depuis l’Ost Politik de Willy Brandt.
La découverte de limites françaises
De son côté, la France se contenta de réactiver certains liens en particulier en Pologne. Sur le plan culturel, les entreprises ouest-allemandes appliquaient une démarche déjà ancienne de balisage informationnel du terrain étant donné la volonté de projection commerciale hors des frontières. Les acteurs économiques français intervinrent en ordre dispersé en s’appuyant sur les canaux diplomatiques du Quai d’Orsay. L’enquête que me fit mener par la suite Roland Dumas, en tant que ministre des Affaires Etrangères pour tenter de comprendre pourquoi les Allemands défendaient mieux que nous leurs intérêts économiques en Albanie, démontra que les diplomates français n’avaient pas les mêmes repères historiques que les acteurs économiques allemands et que les leurs étaient plus pertinents.
Mon travail de recherche appliquée me permit de mieux comprendre la différence de pratique entre les deux pays. La France avait renoué des relations diplomatiques avec Tirana alors que ce n’était pas le cas de l’Allemagne. Paris avait donc un avantage qui ne fut pas exploité. Les Allemands avaient un désavantage supplémentaire dans la mesure où les autorités albanaises leur réclamaient encore des dommages de guerre à la suite de l’invasion de leurs territoires par la Wehrmacht au cours de la seconde guerre mondial. Mais les Allemands négocièrent des compensations et se firent plus pragmatiques. Ces différences d’approche me mirent progressivement sur la voie d’une analyse comparée des techniques de guerre économique du temps de paix.
Différence d’approche à propos du concept de guerre économique
En 1971, Bernard Esambert avait déjà évoqué dans un article la notion de guerre économique[2] qu’il contextualise vingt ans plus tard à partir d’un premier bilan tiré de son expérience professionnelle[3]. La sortie de la guerre froide focalise son attention sur l’importance de la mondialisation des échanges qui structure son approche de la guerre économique en soulignant que la conquête des marchés a supplanté la conquête des territoires. Son analyse a donc été centrée sur la compétition, l’importance de l’innovation et de l’exportation, ainsi que la recherche de la prospérité. Son constat est clair : pas d’économie forte sans industrie puissante et rentable, pas de rayonnement sans économie forte. Bernard Esambert ne formule pas de grille de lecture pour expliquer les politiques de reconstitution ou d’accroissement de puissance par le biais de pratiques de guerre économique du temps de paix. Il fonde son analyse sur la comparaison des chiffres en termes de production et de commerce extérieur. Et il en déduit un classement de la performance par l’analyse des excédents extérieurs de pays tels que le Japon et l’Allemagne.
Une telle approche l’amène à faire débuter la guerre économique au sens moderne » à 1962/1963, c’est-à-dire à partir de l’intensification des échanges internationaux ainsi que la plus forte croissance du commerce extérieur par rapport à la production nationale. Selon lui, l’innovation et l’invention technique sont devenus les « aliments essentiels de la guerre économique ». Cette vision centrée sur les dynamiques de marché l’amène même à dire que la dispersion des dépendances permet de recouvrer une certaine indépendance.
Une telle approche ne prend pas en compte la nature très diversifiée des affrontements hors marché ainsi que l’origine politico-culturelle des confrontations géoéconomiques entre puissances. L’analyse principalement économiste de Bernard Esambert est insuffisante pour expliquer les particularismes nationaux de la guerre économique : le particularisme du Japon au début de l’ère Meiji (éviter la colonisation occidentale), ou le particularisme de la Chine communiste au début de l’ère de Deng XiaoPing (éviter un effondrement à la soviétique). L’alternative stratégique entre conquête territoriale et conquête commerciale n’est pas non plus prise en compte par Bernard Esambert. Il en est de même du cadre structurant de la guerre économique comme le démontre par exemple la prise du contrôle politico-militaire des ressources pétrolières à travers le monde par la Grande Bretagne puis par les Etats-Unis, entre la fin du XIXe siècle et la fin du XXe siècle.
Cette série d’angles morts dans la pensée d’Esambert m’a incité à aller plus loin dans l’étude de la guerre économique.
Une lecture stratégique de la guerre économique
En 1989, Jean-Pierre Quignaux, secrétaire général d’Aditech me commande la rédaction d’une étude qui sera elle aussi financée par le CPE du ministère de la Recherche. L’objectif est de réaliser une analyse comparée des stratégies de puissance dans le domaine géoéconomique : Techniques offensives et guerre économique[4].

Pour traiter cette thématique, je m’inspire de la démarche d’analyse comparée préalablement testée à propos de l’importance des contextes nationaux, culturels et géopolitiques dans la configuration d’une culture du renseignement. J’oriente cette étude sur l’analyse des rapports de force entre puissance sur le plan économique et plus particulièrement sur le rapport de force du faible au fort entre économies de combat dominantes et économies sur la voie de l’expansionnisme. Ainsi émerge un début de grille de lecture sur l’usage offensif de l’information et du renseignement. Deux pistes sont mises en avant : les stratégies indirectes[5] et la problématique d’accroissement de puissance par l’économie.
Notes
[1] Créée à l’origine pour valoriser les travaux du Centre de Prospective et d’Evaluation du Ministère de la Racherche, Aditech a développé des activités de veille ainsi que des publications complémentaires à sa feuille de route. Des anciens du SGDN
[2] Bernard Esambert, La guerre économique mondiale, Paris, Olivier Orban, 1991.
[3] Il fut notamment conseiller industriel du Président Georges Pompidou, et est présenté comme un des inspirateurs des grands programmes industriels du pompidolisme.
[4] Christian Harbulot, Techniques offensives et guerre économique, Paris, Aditech, 1991.
[5] Défense nationale et rivalités stratégiques non militaires : la France face au défi des stratégies indirectes. Rapport final de synthèse du programme de recherche 1989 / 1991 du Centre de recherches Droit et Défense. Date de publication : 1992.