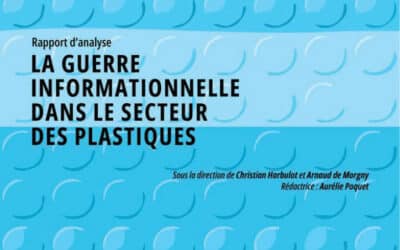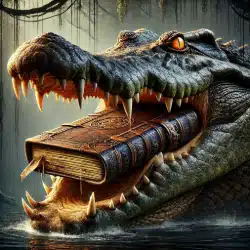Le 26 octobre 2024, le CR451 organisait le 1er colloque international sur la guerre économique du temps de paix .
Cette synthèse rédigée par Nicolas Moinet et Arnaud de Morgny a été initialement publiée dans la Revue internationale d’intelligence économique- R2IE .
Mots clefs en français : Guerre économique, Économie de guerre, Rapports de force, Monde matériel, Monde immatériel, Sécurité économique, Compétition, Contestation, Affrontement, Temps de guerre, Temps de paix, Martialisation
Mots clefs en anglais : Economic warfare, War economy, Power relations, Material world, Immaterial world, Economic security, Competition, Contestation, Confrontation, Wartime, Peacetime, Weaponization
Résumé:
Le premier colloque international du 26 octobre sur la guerre écomique du temps de paix a approfondi la distinction entre économie de guerre, guerre économique du temps de guerre et du temps de paix. Les intervenants ont mis en lumière l’importance sous-estimée des rapports de force économiques dans les stratégies de sécurité économique contemporaines. La martialisation de l’interdépendance économique a été largement évoquée comme symptôme de la compétition globale accrue. Les débats ont aussi porté sur la nécessité de développer des mécanismes plus proactifs en matière d’intelligence économique pour contrer les menaces de prédation financière et technologique. Des exemples précis ont illustré comment la compétition économique pouvait devenir un outil d’accroissement de puissance nationale. Le rôle des institutions européennes, comme incubateurs involontaires de conflits économiques internes, a été critiqué pour leur manque de vision stratégique claire. Le concept de guerre économique systémique a été introduit pour mieux cerner les attaques économiques cachées sous couvert d’influence culturelle ou environnementale. Enfin, les intervenants ont plaidé pour une sortie des approches défensives traditionnelles, favorisant une stratégie offensive claire face aux nouvelles menaces économiques globales.
Sumary :
The first international colloquium on economic warfare during peactime, held on 26 October, explored the distinction between the economy of war, wartime economic warfare and peacetime economic warfare. The speakers highlighted the underestimated importance of economic power relations in contemporary economic security strategies. The weaponization of economic interdependence was widely discussed as a symptom of increased global competition. Discussions also focused on the need to develop more proactive economic intelligence mechanisms to counter the threats of financial and technological predation. Specific examples illustrated how economic competition could become a tool for increasing national power. The role of European institutions as unwitting incubators of internal economic conflict was criticised for their lack of a clear strategic vision. The concept of systemic economic warfare was introduced to better identify hidden economic attacks under the guise of cultural or environmental influence. Finally, the speakers called for a move away from traditional defensive approaches towards a clear offensive strategy in the face of new global economic threats.
Compte-rendu du colloque
« La guerre économique du temps de paix »
Le 26 octobre s’est tenu le premier colloque international traitant de la guerre économique du temps de paix. Ce colloque était organisé conjointement par Mme Gisèle Jourda, sénatrice de l’Aude et le centre de recherche appliquée de l’école de guerre économique, le CR451. Lors de cette journée plus de 200 participants ont assisté à ces travaux dans la salle Clémenceau au sein du Palais du Luxembourg.
Mme Gisèle Jourda et M. Christian Harbulot introduisent la journée.
Gisèle Jourda est sénatrice de l’Aude, Vice-Présidente de la commission des affaires européennes, Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et Membre de la délégation parlementaire au renseignement.
Lors de son introduction, Mme Jourda souligne l’importance et la complexité des enjeux liés aux ingérences étrangères. Elle relève que malgré une prise de conscience accrue des dimensions géopolitiques et militaires, les aspects économiques restent sous-estimés dans les débats publics et politiques. Elle plaide pour une meilleure évaluation des risques liés aux investissements étrangers stratégiques.
Elle déplore l’absence d’une véritable politique de sécurité économique, constatant l’inadaptation du cadre juridique actuel face à une menace persistante et croissante depuis les années 1980. Elle décrit cette menace sous diverses formes telles que les raids financiers, les attaques cybernétiques, la prédation d’informations stratégiques ou l’application extraterritoriale de législations étrangères, soulignant l’ambiguïté persistante entre influence et ingérence.
Elle critique particulièrement certaines décisions comme celle permettant à un ancien directeur de la DGSI de rejoindre une société américaine spécialisée dans le respect des sanctions économiques imposées par les États-Unis, signe d’un aveuglement stratégique selon elle.
La sénatrice insiste sur l’urgence d’identifier clairement rivaux et menaces, afin de développer des outils efficaces de protection à court, moyen et long terme. Elle souligne que malgré la popularité croissante du concept de souveraineté dans les discours publics récents, notamment à l’occasion des élections européennes et législatives, la France demeure exposée et vulnérable face aux stratégies offensives des puissances étrangères.
En conclusion, elle appelle à une mobilisation collective pour affiner la notion de « guerre économique » et renforcer son rôle stratégique au sein des politiques économiques, diplomatiques et scientifiques.
Christian Harbulot à sa suite présente les enjeux de ce colloque et en particulier explique son titre et donc son objet.
Christian Harbulot est un expert international en intelligence économique, il a initié des travaux de recherches sur les problématiques d’affrontements économiques et les stratégies de puissance depuis le milieu des années 1980. Il a cofondé l’Ecole de guerre économique en 1997. Depuis le début des années 2000, il concentre ses travaux sur les questions de guerre cognitive et de guerre de l’information par le contenu. Il a créé en janvier 2022 le CR 451, le centre de recherche de l’EGE, dédié à cette démarche.
Selon lui, la guerre économique est un concept récent qui a commencé à être appliqué puis théorisé au cours du XXe siècle. Rappelons à ce propos que Winston Churchill fut le premier chef de gouvernement occidental à avoir créer un ministère de la guerre économique[1] au début de la seconde guerre mondiale pour combattre la machine de guerre nazie. En France, quelques historiens tels que Georges-Henri Soutou[2] ont commencé à lui donner une certaine visibilité dans le monde académique. Mais c’est l’impulsion donnée par l’école de pensée issue de l’intelligence économique qui est à l’origine de l’édition de nombreux ouvrages sur l’histoire et les enjeux de la guerre économique, plus précisément en période de paix.
Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, la notion de guerre économique est désormais rentrée dans le domaine public.
Pour cerner ce que recouvre le concept de guerre économique, C. Harbulot précise qu’il faut différencier trois champs d’application :
- « L’économie de guerre ». La participation à une guerre militaire suscite des besoins qui sont satisfaits prioritairement par un prélèvement des ressources de l’économie sur une grande échelle. Dans ce cadre, l’État met sous tutelle une partie des entreprises pour les intégrer dans une planification autoritaire afin de garantir aux armées la disponibilité des moyens dont elles ont besoin.
- La guerre économique « du temps de guerre ». Elle fait référence aux opérations offensives pour parasiter les circuits d’approvisionnement de l’ennemi et affaiblir les capacités de survie de la population adversaire.
- La guerre économique « du temps de paix » est une confrontation entre parties pour capter, contrôler, accaparer des richesses, accroître sa puissance. Elle génère un mode de domination qui évite de recourir à l’usage de la puissance militaire pour imposer une suprématie durable.
Si les notions « d’économie de guerre » et de pratique de la guerre économique « du temps de guerre » sont documentées dans des textes officiels[3] ou dans des revues académiques[4], ce n’est pas le cas de la notion de guerre économique « du temps de paix ». Cette dernière n’a pas de reconnaissance officielle de la part des Etats et a été rarement abordée sur le terrain académique. Il existe cependant une exception française dans la mesure où l’Ecole de Guerre Economique a cherché à définir une première approche pédagogique du rôle de l’information et de la connaissance dans les affrontements économiques du temps de paix. Cet effort a été poursuivi en 2022 grâce à la création de son centre de recherche appliquée, le CR451, pour mener à bien des travaux approfondis sur la manière dont des secteurs industriels pouvaient être concernées par des pratiques de guerre économique « du temps de paix ». Cette démarche a abouti à la production d’un premier rapport sur la guerre économique dans la plasturgie[5].
Harbulot met alors l’accent sur la notion de « machines de guerre économique ». Ce sont les exemples[6] tirés du contexte asiatique qui vont donner à la guerre économique « du temps de paix » une dimension stratégique, en raison de la dynamique collective voulue par le pouvoir politique. Les raisons qui incitent le pouvoir politique à donner naissance à des « machines de guerre économique » peuvent être illustrées par trois exemples très différents :
- Le refus du Japon d’être colonisé par le monde occidental.
- La volonté de la Corée du Sud de ne pas être absorbée par la Corée du Nord.
- La détermination de la Chine à ne pas changer de modèle politique.
Chacun de ces exemples présente un point commun : la volonté du pouvoir politique de mobiliser les forces vives du pays par rapport à une menace extérieure majeure. Un tel choix stratégique s’est concrétisé par la création de véritables machines de guerre économique adaptées aux besoins des pays en question. « Une machine de guerre économique[7] » peut être définie comme l’ensemble des moyens techniques, financiers et humains, destiné à bâtir les bases d’une politique d’expansion commerciale centrée sur la conquête de marchés extérieurs.
Premier exemple : Le Japon
A la fin du XIXe siècle, le Japon a été menacé explicitement par un risque de confrontation militaire avec les Etats-Unis d’Amérique. La lettre remise par le commodore Matthew Perry de la marine des Etats-Unis au Shogun proposait l’ouverture du commerce entre les deux pays ou la guerre. Le Japon accepta la proposition mais opta pour une politique d’industrialisation qui ouvrit la voie à une démarche commerciale conquérante. Pour se donner les moyens de réussir sa politique d’expansion économique[8], la « machine de guerre économique japonaise » construite à cet effet a subi une évolution en plusieurs étapes : usage d’un système de planification au début de l’ère Meiji, essor et mutation progressive des conglomérats industriels privés, rôle incitatif des organismes administratifs (MITI[9], JETRO[10]), appui opérationnel des sociétés de commerce dans l’approche des marchés extérieurs.
Second exemple : la Corée du Sud
A la sortie de la guerre de Corée, ce pays est quasiment sans industrie. L’occupant japonais qui dirigeait le pays jusqu’en 1945, les avait construites sur le territoire de la Corée du Nord). Pour éviter de subir les contrecoups d’un tel décalage, la Corée du Sud a inventé de manière autoritaire une matrice de développement qui favorise la création de plusieurs pôles industriels très compétitifs. La notion de guerre économique telle qu’elle est pensée à Séoul est conditionnée par la possibilité d’un nouvel affrontement militaire avec la Corée du Nord.
Troisième exemple : la Chine communiste
Harbulot rappelle que l’effondrement de l’Union soviétique oblige le parti communiste chinois à modifier le système économique chinois pour ne pas subir le même sort. La manière dont a été pensée la politique de la main tendue vers l’Occident relève d’un art de la guerre économique « du temps de paix » qui mérite d’être souligné. Il a consisté dans un premier temps à aller chercher la manière de faire au Japon[11]. En parallèle à cette réappropriation de savoir-faire nippon, la Chine a présenté comme une opportunité pour les entreprises occidentales de délocaliser une partie de leur outil de production sur certaines parties de son territoire[12]. Derrière cette offre en apparence avantageuse (bas salaires et possibilités d’écouler les produits occidentaux sur le marché intérieur chinois), le parti communiste chinois avait pour objectif de capter le maximum de transferts de technologie.
Le conférencier met en avant les points communs de ces trois exemples :
- Les stratégies de raccourcis : aller chercher la connaissance hors des frontières (se faire passer pour un faible pour faciliter l’approche du fort afin de tirer le maximum de leçons à étudier et éventuellement à copier).
- La combinaison de l’intérêt national et de l’intérêt privé : imposer aux dirigeants d’entreprise une approche patriotique par rapport à l’extérieur tout en préservant une certaine concurrence sur un marché intérieur.
- La place très importante accordée au renseignement économique.
- Un usage courant des offensives informationnelles.
Les expériences japonaise, sud-coréenne et chinoise ont fourni des éléments de démonstration de la rentabilité[13] de la guerre économique « du temps de paix » en termes d’accroissement de puissance. Le Japon a réussi à se hisser temporairement au second rang de l’économie mondiale à la fin des années 1980. La Corée du Sud est devenue une puissance industrielle particulièrement performante et a réussi jusqu’à présent à faire face au défi permanent des Nord-coréens soutenus par Pékin. La Chine communiste est la deuxième puissance économique mondiale en 2025.
L’étude de la guerre économique « du temps de paix » ne doit plus rester un angle mort comme ce fut le cas jusqu’à une période récente. La société de l’information démultiplie les failles et les menaces qui pèsent sur les entreprises. Par ailleurs, l’évolution de certains conflits qui s’inscrivent dans la longue durée (exemple du Moyen Orient), donne une dimension globale à la guerre économique, ce qui crée de facto une interaction entre ses trois champs : guerre économique « du temps de paix » (problème de l’accès à l’eau et aux ressources pétrolières ou gazières), économie de guerre (capacité à maintenir le niveau des équipements militaires) et guerre économique « du temps de guerre » (destruction des infrastructures portuaires et des centres de stockage de produits stratégiques).
Mais comme le rappelle Christian Harbulot en prenant exemple sur les aléas de la guerre en Ukraine ainsi que ceux des guerres au Moyen-Orient, les trois dimensions de la guerre économique sont désormais interactives et causent l’évolution hybride des rapports de force entre puissances.
En guise de conclusion, il indique qu’il n’en demeure pas moins vrai qu’il est nécessaire d’accorder une attention particulière aux affrontements économiques « du temps de paix », compte tenu de la fragilisation des « lois du marché » face aux politiques d’accroissement de puissance par l’économie ainsi que de l’importance croissante de la notion de « dépendance » entre les pays qui recherchent la suprématie économique et ceux qui la subissent.
1ère TABLE RONDE : la guerre économique : un concept incontournable des relations internationales
La première séquence animée par Arnaud de Morgny, réunissait les professeurs Greg Kennedy, Nicolas Moinet, Yves Tiberghien et Jacques Sapir
La montée en puissance du concept de sécurité économique dans la zone indopacifique.
Le professeur Yves Tiberghien de l’Université de « British Columbia », enseigne la science politique. Il est le directeur émérite de l’Institut de recherche asiatique, UBC. Né en France, il a occupé des postes importants au Japon, notamment chez Michelin et comme chercheur au ministère des Finances japonais. Son parcours académique inclut des passages prestigieux à Stanford et Harvard, où il a complété son doctorat et postdoctorat. Installé au Canada depuis 24 ans, il se définit désormais comme franco-canadien.
Son travail porte principalement sur la sécurité économique, avec un intérêt particulier pour l’Amérique du Nord et l’Asie (Chine, Japon, Corée, Taïwan). En 2023, il a participé activement à des dialogues « Track 1.5 », associant des think-tanks et des responsables gouvernementaux de haut niveau, centrés sur les enjeux économiques entre la Chine et les États-Unis.
Selon lui, historiquement, et cela depuis les années 1980, la sécurité et l’économie étaient traitées séparément au sein des gouvernements et des institutions internationales. Cependant, cette séparation s’est effritée récemment, conduisant à une crise profonde de l’ordre libéral international tel que théorisé par John Ikenberry. Cette crise se manifeste notamment par une transition majeure du pouvoir économique des pays occidentaux vers la Chine et le Sud global. Le recul relatif de l’OCDE et du G7 au profit d’économies émergentes a profondément transformé le paysage économique mondial et remis en question l’autorité historique des puissances traditionnelles.
Il marque l’évolution entre les comportements des Etats en 2015 et ceux contemporains, illustrant ainsi l’évolution de leurs rapports. En effet, en 2015, les contentieux commerciaux étaient réglés selon les règles de l’OMC. Economie et sécurité relevaient de régimes différents. Les puissances majeures se réunissaient lors des G20 et avançaient sur des règles globales. En 2009, elles avaient collectivement sauvé l’économie globale et tous avaient signé les accords de Paris. Enfin les réseaux sociaux et l’IA n’étaient pas perçus comme des dangers pour la démocratie.
De nos jours, le mécanisme de règlements des conflits de l’OMC est bloqué par le véto des Etats-Unis. Un phénomène de « martialisation[14] de l’interdépendance » (weaponization of interdependance) s’est développé. Nous sommes dans une situation de confrontation entre grandes puissances. Il existe la possibilité d’une guerre froide entre la Chine et les Etats-Unis. Les blocages politiques se généralisent. La guerre en Ukraine a quasiment tué le G20. Nous assistons à des tensions majeures sur le climat et à des politiques de retour en arrière. Enfin les Mega plateformes (Telegram, Twitter-X, FB) et l’IA semblent être devenues des risques existentiels
Le blocage de l’Organe de règlement des différends de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), résultat du veto américain, symbolise l’évolution vers un monde où l’interdépendance économique devient une source majeure de vulnérabilité stratégique plutôt qu’une opportunité. Cette dynamique est particulièrement exacerbée dans le cadre de la confrontation technologique entre les États-Unis et la Chine, notamment autour des technologies numériques et vertes, considérées comme cruciales pour la domination économique et sécuritaire du futur.
Les mesures de sécurité économique désignent les mesures prises par l’État pour protéger l’accès aux intrants essentiels à l’économie nationale, tels que l’énergie, la nourriture, l’eau, les médicaments, le capital, la technologie, la propriété intellectuelle, les infrastructures et les composants essentiels.
Elles peuvent également inclure l’accès aux marchés critiques et aux voies maritimes menant à ces marchés. Différents pays mettent l’accent sur différents composants et éléments.
Les typologies d’action de sécurité économique sont :
- Garantir un accès crédible à long terme aux intrants clés dans un contexte de perte de confiance dans le marché mondial, alors que la mondialisation atteint son paroxysme, que l’OMC et le système commercial sont paralysés et que les mesures non commerciales se multiplient.
- Établir un nouvel équilibre optimal entre l’État et le marché pour atteindre une nouvelle série d’objectifs : prospérité, sécurité et résilience sociale.
- Se protéger contre la tendance croissante à l’interdépendance militarisée, où des acteurs clés utilisent le contrôle asymétrique de nœuds clés ou de goulets d’étranglement de l’économie mondiale pour faire pression sur d’autres (y compris la diplomatie économique).
- Garantir l’accès aux nouveaux intrants et établir une position dominante dans les nouvelles technologies essentielles (IA et technologies vertes) qui domineront l’économie des années 2030.
- Faire face à la concurrence géopolitique croissante et chercher à refuser les intrants aux établissements militaires des rivaux. Les préoccupations en matière de sécurité comprennent également la protection des infrastructures socio-économiques physiques et virtuelles clés (y compris contre les cyberattaques).
Des pays comme le Japon et la Corée du Sud ont mis en œuvre des politiques volontaristes et interventionnistes pour renforcer leurs capacités technologiques et économiques, particulièrement dans le secteur stratégique des semi-conducteurs. Par exemple, le Japon a récemment engagé des investissements massifs pour attirer cette industrie sur son territoire.
Les États-Unis, quant à eux, ont développé sous l’administration Biden un ensemble d’instruments particulièrement robustes, comprenant à la fois des sanctions économiques sévères contre la Chine et d’importantes subventions destinées à sécuriser leur avance technologique, notamment dans les secteurs de l’intelligence artificielle et des technologies vertes. Cette double approche produit des externalités importantes, impactant même leurs alliés européens.
Le Canada se trouve dans une situation intermédiaire, marquée par une certaine ambivalence liée à son attachement historique à l’ordre économique libéral et à l’État de droit. Face aux nouvelles réalités géopolitiques, le pays est cependant contraint de repenser ses stratégies économiques en intégrant davantage la dimension sécuritaire, ce qui génère des tensions internes et des difficultés d’adaptation.
Il est aussi important de comprendre que la notion de sécurité économique dans les cas précité comprend un volet offensif évident. Ce que le professeur Tiberghien évoque sous le terme d’externalités négatives rassemble en fait les politiques offensives dans le cadre du concept de sécurité économique.
Au-delà des cas nationaux, l’ensemble des pays de la région Indopacifique semble désormais engagé dans une « course à la sécurité économique », adoptant des mesures défensives initiales qui engendrent cependant des effets secondaires négatifs significatifs pour leurs voisins et partenaires économiques. La multiplication de ces mesures risque de déclencher une spirale conflictuelle où les externalités générées aggravent les tensions économiques et géopolitiques existantes.
Cette période complexe est aussi marquée par deux révolutions industrielles simultanées : la révolution numérique et celle des technologies vertes, bouleversant les équilibres économiques mondiaux et obligeant les États à se positionner rapidement sous peine de déclin économique et sécuritaire. L’Europe, prise en étau entre la Chine et les États-Unis, se trouve face à un dilemme existentiel dans cette compétition intense.
Il identifie cinq types de risques :
- Ces mesures ont des effets de distorsion, voire des effets négatifs, sur d’autres.
- D’autres sont susceptibles de réagir, ce qui conduit à un processus d’accélération de la réciprocité, qui s’apparente à une course aux armements et qui entraîne une diminution nette de la sécurité pour tous, voire pour chaque individu, au fil du temps.
- Effets de contagion : dans une économie donnée, les mesures de sécurité économique sont une pente glissante (cf. Gita Gopinath au FMI), à la fois sur le plan interne et en termes d’engagement crédible vis-à-vis des autres. Elles permettent aux établissements de sécurité de sécuriser et de démarchandiser une part de plus en plus importante de l’économie.
- La définition de la sécurité économique est très difficile à atteindre et varie d’un pays à l’autre, ce qui peut conduire à des types de contre-mesures de plus en plus nombreux.
- Si elles ne sont pas neutralisées, les interactions stratégiques en matière de sécurité économique peuvent entraîner l’effondrement de certaines parties du système économique mondial et aggraver la situation de tous.
En conclusion, le professeur Tiberghien rappelle que la sécurité économique contemporaine est un concept hybride, qui intègre désormais étroitement des logiques économiques et sécuritaires. Cette intégration bouleverse les structures institutionnelles et les pratiques internationales, plongeant le monde dans une ère d’incertitude accrue. L’enjeu majeur actuel est donc de trouver un équilibre entre sécurité stratégique et coopération économique internationale afin d’éviter une escalade néfaste pour tous.
La guerre économique en temps de guerre et de paix
Le professeur Greg Kennedy Greg Kennedy enseigne la politique étrangère stratégique au King’s College de Londres et a rejoint le département des études de défense en juin 2000. Il a enseigné au Collège militaire royal du Canada, à Kingston, Ontario, Canada, dans les départements d’histoire et d’études sur la guerre. Il est professeur adjoint de cette université. Il est titulaire d’un doctorat de l’université d’Alberta, d’une maîtrise en études sur la guerre du Collège militaire royal du Canada et d’une licence (avec mention) en histoire de l’université de Saskatchewan. Il a publié des ouvrages internationaux sur les questions de politique étrangère stratégique, la défense maritime, le désarmement, la diplomatie et le renseignement.
L’intervention du Dr. Kennedy, en anglais intitulée « economic warface in peace and war» (la guerre économique en temps de guerre et de paix) explore les dimensions et enjeux contemporains de la guerre économique (economic warfare), en soulignant qu’elle ne constitue pas simplement une réédition de la guerre froide, mais représente une forme hybride intégrant divers éléments issus de conflits historiques tels que les deux Guerres Mondiales ou la guerre franco-prussienne.
Selon lui, la situation internationale est celle d’une concurrence entre pairs, d’une nouvelle compétition entre grandes puissances. Et cela malgré le conflit russo-ukrainien qui est caractérisé par un conflit de valeurs et non d’idéologie, il n s’agit pas non plus de bipolarité. Faisant référence à la théorie de la super compensation qui décrit différentes phases de réaction à un effet d’entrainement : le stimulus est à l’origine d’une phase de fatigue puis de récupération, suivi par une période de super compensation et finalement d’un retour à la situation ex ante. Pour le professeur Kennedy, la période de super compensation est encore loin. Nous sommes dans la phase d’entraînement intense et de fatigue, pas même dans la phase de récupération, et il reste donc beaucoup de chemin à parcourir avant d’arriver à la super compensation. Il y a cependant des actions à mener pendant la période d’entraînement intense qui peuvent rendre les effets de la phase de super compensation plus puissants.
Il différencie, en particulier, les outils en fonction de ce qu’il qualifie de guerre économique chaude ou froide. Dans le cas d’une guerre économique chaude, les armes sont les embargos, les blocages commerciaux, les « bombardements stratégiques » et les achats préventifs. En cas de guerre économique froide, il s’agit des sanctions économiques ou des sanctions diplomatiques.
Il indique que de plus en plus d’acteurs étudient les différentes modalités des tensions économiques et que s’ils n’utilisent pas le terme de guerre économique lui préférant celui de géoéconomie ou celui de leviers économiques (economic leverage), il s’agit de la même réalité. Il présente en particulier la semaine « géoéconomie » d’Helsinky qui a été organisée en Août 2024 et qui a traité de ces sujets.
Il insiste sur la réémergence des grandes puissances dans le contexte actuel, marqué par une mondialisation accrue, générant des tensions et frictions malgré l’interconnexion économique internationale.
L’histoire a montré que le changement est important pour le système international et qu’il perturbe les méthodologies antérieures de gouvernance et de conflit. Auparavant, il s’agissait de méthodes de contrôle, de création de crédit, de confiance dans le système. Aujourd’hui, les défis concernent les marchés libres, la circulation des marchandises. Le rôle de l’État s’est considérablement accru dans tous les domaines, comme nous l’avons vu dans la pandémie : l’État est le pourvoyeur ultime de pouvoir.
Le Pr. Kennedy décrit une période caractérisée par un immobilisme occidental, une mentalité « business as usual », traduisant une réticence à modifier les modèles traditionnels de gestion de l’économie, malgré l’évolution rapide des règles du jeu économique mondial. Une forme de conservatisme et d’inadaptation de l’occident face aux changements du Monde. Cette inertie contraste avec la stratégie proactive d’acteurs comme la Chine, qui détient aujourd’hui un levier stratégique majeur avec le contrôle de 70 % de la production mondiale de médicaments essentiels, créant ainsi une vulnérabilité notable pour l’Occident. Ce contrôle pourrait permettre à la Chine d’exercer une pression économique significative sans avoir recours à une confrontation militaire directe.
Face à ces nouveaux défis, le Pr. Kennedy constate un mouvement général vers davantage de régulation économique, marquant une rupture avec les doctrines économiques libérales du laissez-faire. Il préconise d’intégrer explicitement les dimensions corporatives et financières dans une matrice de sécurité économique nationale afin de mieux répondre aux menaces économiques émergentes. Cette évolution est visible dans divers pays occidentaux, comme les États-Unis, le Japon ou encore l’Union européenne, qui tendent progressivement à mettre en place des institutions dédiées à la coordination des leviers économiques nationaux dans une optique tant défensive qu’offensive.
L’intervenant met particulièrement en exergue l’importance stratégique du domaine maritime dans la guerre économique actuelle. Selon lui, le contrôle des voies maritimes constitue un impératif absolu pour la préservation de l’ordre international libéral. Il argumente que depuis 250 ans, l’hégémonie économique occidentale repose en grande partie sur sa capacité à assurer une libre circulation des marchandises par les voies maritimes internationales, assurant ainsi prospérité, crédit et stabilité financière.
Par ailleurs, la nécessité d’intégrer l’intelligence artificielle (IA) à la stratégie de sécurité économique est soulignée comme indispensable pour gérer la complexité croissante de la guerre économique. L’IA est identifiée comme un outil critique permettant aux États de traiter efficacement la quantité massive d’informations nécessaires à la prise de décisions stratégiques dans un contexte économique globalisé et hautement compétitif.
Enfin, le Pr. Kennedy affirme que le modèle occidental de guerre économique doit impérativement se concilier avec les valeurs démocratiques et libérales pour préserver sa légitimité à l’échelle mondiale. La démocratie, selon lui, ne doit pas être sacrifiée au profit de la sécurité économique, mais au contraire, être intégrée à une stratégie de guerre économique équilibrée et résiliente. Il rappelle que, historiquement, les démocraties qui ont su articuler leur puissance économique à leurs principes démocratiques ont démontré une meilleure capacité d’adaptation, une résilience accrue et donc une plus grande efficacité.
En conclusion, le conférencier appelle à abandonner l’inertie actuelle au profit d’une stratégie proactive et intégrée, impliquant corporatisme, régulation économique, contrôle des chaînes d’approvisionnement critiques et renforcement du domaine maritime. Ce changement stratégique s’impose comme une nécessité absolue pour faire face aux nouvelles réalités de la guerre économique contemporaine.
L’accroissement de la puissance par l’économie
Le professeur Nicolas Moinet est Enseignant-chercheur à l’Université de Poitiers (IAE – CEREGE) et chercheur associé au CR 451.
Le Professeur Nicolas Moinet entame son exposé en proposant un tableau impressionniste de la notion d’accroissement de puissance et de guerre économique. Il souligne la polysémie du terme « guerre économique » et la difficulté qu’a la France avec les concepts polysémiques. Contrairement à une vision analytique simpliste, il prône une approche holistique à la Edgar Morin pour appréhender la complexité de ce phénomène.
Le professeur note qu’il existe un consensus général sur les effets et les manifestations de la guerre économique, citant notamment les prises de contrôle, les cyberattaques et les intrusions, et rend hommage à la DRSD pour avoir été un des premiers services français à aborder publiquement la notion. Cependant, il insiste sur la nécessité d’aller au-delà de ces manifestations et de définir clairement ce qu’est la guerre économique, qui renvoie inévitablement à la notion de guerre. Il rappelle que la conception de la guerre a été marquée par le XXe siècle et son déchaînement de violence létale, ce qui a pu masquer les formes de guerres plus hybrides intégrant l’économique. Pour mieux comprendre la guerre économique actuelle, il suggère de se tourner vers les exemples du XIXe et de la fin du XXe siècle, probablement plus proches du contexte actuel marqué par la dissuasion nucléaire.
Selon lui, la guerre économique n’est pas une métaphore. La guerre, de manière générale, est définie comme une agression collective et organisée, un acte de violence visant la soumission de l’autre par divers moyens : cognitif, informationnel, économique ou létal. Il cite Sun Tzu pour rappeler que l’usage de la force létale doit être un dernier recours. Il met en lumière la nature souvent dissimulée des actes de guerre économique, masqués par un « rideau extrêmement puissant du complotisme ». Pour contrer cela, il préconise des méthodologies d’analyse s’inspirant de l’archéologie et du paradigme indiciaire, ainsi que des approches multidisciplinaires intégrant notamment l’économie politique. Le CR 451 définit la guerre économique comme une confrontation entre différentes parties prenantes (États, entreprises, acteurs, hackers, ONG) pour capter et contrôler des ressources, accaparer des richesses et surtout accroître sa puissance par l’économie.
Il identifie cinq axes d’accroissement de cette puissance : la limitation des dépendances (y compris par l’interdépendance comme dans le cas des semi-conducteurs), la localisation de l’activité industrielle, la capacité à se projeter sur les marchés extérieurs, l’entrée dans la compétition informationnelle (l’impact des cabinets de consultants, des juristes, etc.), et la lutte contre la prédation économique. Il insiste sur la nécessité d’adopter une logique offensive et non uniquement défensive. Le professeur souligne l’importance de changer de paradigme stratégique et d’adopter les perspectives des autres, insistant sur la nécessité d’une vision à 360° intégrant les points de vue de tous les pays du monde. Il encourage à remettre en question les idées établies et à adapter les outils d’analyse.
Au CR 451, diverses grilles d’analyse sont proposées, dont celle des « échiquiers invisibles ». Cette approche consiste à considérer non seulement l’échiquier concurrentiel classique mais aussi les échiquiers géoéconomique, politique et de la société civile, où des stratégies peuvent se déployer simultanément. L’étude du pétrole au XIXe et XXe siècles, notamment le cas de Rockefeller et de la Standard Oil, illustre cette approche en montrant comment une entreprise peut agir sur plusieurs de ces échiquiers. Le démantèlement de la Standard Oil est présenté comme un exemple de la capacité des États-Unis à renforcer leur puissance en adaptant leurs structures (Cahiers de la guerre économique n°4 & 5 dirigés par Christian Harbulot, 2021).
L’exposé aborde ensuite la manière dont cette logique de puissance est prise en charge par les « machines de guerre économique », notamment le renseignement, de manière différenciée selon les pays. Le Royaume-Uni, précurseur dans ce domaine pour protéger son empire et ses intérêts pétroliers, a développé une politique étrangère en conséquence. Les États-Unis ont utilisé le pétrole comme une arme géopolitique, notamment via leur alliance avec l’Arabie Saoudite. La Russie utilise également le pétrole comme une arme de résilience. La France, quant à elle, a compris ces enjeux avec retard, mais a su, sous de Gaulle, créer une compagnie patriote comme Elf pour défendre ses intérêts.
Le professeur Moinet évoque l’ouvrage d’Amin Maalouf Le Labyrinthe des égarés (Grasset, 2024) pour rappeler que le passé ne meurt jamais et illustre cela avec l’ouverture forcée du Japon par le Commodore Perry en 1853, une démonstration de puissance qui a contraint le Japon à s’ouvrir au commerce. Cette ouverture a conduit à un modèle d’accroissement de puissance par l’économie, caractérisé initialement par l’espionnage économique pour rattraper le retard technologique. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a misé sur le développement économique avec l’aide de l’État, connaissant un essor fulgurant et devenant une puissance économique mondiale dans les années 1980 grâce aux technologies de l’information. Face à la montée en puissance économique du Japon, les États-Unis ont commandé le rapport Japan 2000 de la CIA (1991), qui a révélé la mise en place d’une doctrine d’intelligence économique japonaise puissante et discrète. Ce rapport a conduit les États-Unis à faire de la défense de leurs intérêts économiques leur priorité numéro un après la quasi-disparition de l’Union soviétique. Ils ont misé sur la Silicon Valley et le « monde immatériel » des technologies de l’information, avec l’objectif d’avoir le leadership sur le marché de l’information privée. Cependant, ils n’avaient pas anticipé la résilience et la montée en puissance de la Chine, qui a développé son propre réseau internet et ses routes commerciales.
Le rattrapage rapide de la Chine s’explique en partie par le transfert de technologies imposé aux entreprises étrangères souhaitant accéder à son marché. Aujourd’hui, la Chine est en phase d’innovation propre, avec des chercheurs chinois récompensés par des prix Nobel. Les États-Unis observent avec anxiété cette évolution, et les relations se sont détériorées avec la guerre commerciale lancée par Donald Trump, perçue comme le début d’une nouvelle forme de guerre.
Le professeur Moinet insiste sur la nécessité pour la France de connaître les grilles de lecture étrangères, notamment celle du Royaume-Uni dont le service de renseignement affiche clairement un objectif de prospérité économique. Il cite des ouvrages doctrinaux importants mais non traduits en français, comme The Weaponization of Everything de Marc Galeotti (2023) et Strategic Supremacy de Richard Daveni (2007). Daveni propose de penser le monde des affaires avec les schémas de la géopolitique, en se concentrant sur la perturbation et la destruction des avantages concurrentiels, et en définissant des zones stratégiques (marché cœur, intérêts vitaux, zones d’endiguement, zone pivot). Il regrette le manque de lien en France entre la réflexion universitaire et la prise de décision politique, contrairement aux États-Unis où les Think tanks et les universitaires jouent un rôle important.
L’exemple des technologies clés et de leur positionnement selon la grille d’analyse de Daveni (semi-conducteurs dans les intérêts vitaux, menant à la confrontation avec la Chine) est éclairant. Le Professeur Moinet mentionne également le rôle des agences gouvernementales, des cabinets de conseil et la circulation des personnes entre les secteurs public et privé aux États-Unis, créant une « machine de guerre » impressionnante. Il cite le National Economic Council américain comme un acteur central de cette stratégie. Il mentionne le succès du livre Chip War qui illustre la guerre des semi-conducteurs, un domaine où l’Europe peine à rivaliser. Il plaide pour un système administratif et politique connecté à la réflexion stratégique et introduit la notion de guerre économique systémique inventée par Christian Harbulot, où, par un processus informationnel et une domination cognitive, un adversaire est soumis. Il illustre cela par l’exemple du financement des mouvements antispécistes par des fondations américaines visant à développer le marché de la viande artificielle.
Enfin, il est crucial de sortir du paradigme séquentiel paix-crise-guerre, qui arrange un système politico-administratif en silos. Le chef d’état-major des armées, le Général Thierry Burkhard, propose une grille de lecture en termes de compétition – contestation – affrontement que le CR 451 transpose dans son domaine en compétition – modélisation – déstabilisation – destruction.
Pour illustrer cette dernière grille, le professeur prend l’exemple de la transition vers le véhicule électrique. Alors qu’en 2008 la Chine annonçait des objectifs ambitieux en matière de voitures électriques, la France restait focalisée sur des modèles spécifiques. La Chine a ensuite agi sur la modélisation en augmentant sa présence dans les instances de normalisation (ISO) et en influençant des pays européens via le groupe « 16+1 » pour faire voter la fin des véhicules thermiques en 2035, favorisant ainsi le marché des véhicules électriques où elle est en avance. La Chine a également ciblé le maillon faible des loueurs de voitures. Malgré des alertes dans la presse, l’Europe n’a pas su mener une contre-guerre informationnelle et a continué à raisonner en termes de compétition classique, en misant sur l’attractivité avec la création de « Giga Factories », dont les résultats sont pour l’instant décevants. L’arrivée de constructeurs chinois comme BYD en Hongrie plutôt qu’en France illustre cette difficulté. Les propos du patron de Renault devant le Sénat mettent en lumière le manque d’analyse d’impact de la décision européenne de fin des véhicules thermiques, notamment en ce qui concerne l’accès aux matières premières nécessaires aux batteries. Cette situation conduit à une déstabilisation, voire une destruction, de l’industrie automobile européenne, comme le soulignent des articles de presse et des analyses de The Economist Intelligence Unit qui évoquent un risque pour l’Europe d’être « engloutie » dans la rivalité économique sino-américaine.
Le professeur Moinet conclut en soulignant qu’on sait ce qu’il faut faire, comme le préconisent des rapports comme la mission sur l’intelligence économique, mais qu’il est nécessaire d’agir avec les moyens adéquats et de dépasser les blocages culturels. Il insiste sur la nécessité de renouer avec une culture de la ruse, rappelant que des ouvrages comme Les Ruses de l’intelligence de Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernant (Champs Essais, 1974) ou La Ruse et la force de l’historien Jean-Vincent Holeindre (Perrin,2017), soulignent la difficulté française à nommer « guerres » ces conflits de ruses, préférant une approche basée sur la force, ce qui constitue plus que jamais un handicap stratégique.
Guerre économique : de quoi parle-t-on ?
Jacques Sapir est un économiste français reconnu pour ses travaux sur l’économie politique, les crises financières et la souveraineté économique. Ancien Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), il dirige également le Centre d’études des modes d’industrialisation (CEMI).
La notion de « guerre économique », selon Jacques Sapir, présente une polysémie notable, car elle recouvre des phénomènes qui vont du simple état de compétition économique à celui de véritables conflits stratégiques, structurés autour d’une logique ami/ennemi. En France, cette notion est souvent définie par les spécialistes de l’intelligence économique comme une stratégie d’État visant à affirmer sa puissance sur la scène internationale à travers divers moyens tels que l’information économique, financière, technologique, juridique, politique et sociétale. E. Delbecque et C. Harbulot soulignent notamment sa proximité avec la guerre cognitive et informationnelle, inscrite dans une dynamique de guerre asymétrique au profit d’un pouvoir étatique global. Cette conceptualisation met en relief une évolution parallèle avec le développement théorique de la stratégie elle-même, reconnue tant par les historiens que par les spécialistes des sciences politiques.
Historiquement, la guerre économique est intrinsèquement liée aux conflits militaires, dès lors qu’elle visait à affaiblir l’adversaire en s’attaquant directement à sa base économique mais elle s’avère incapable de saisir l’ensemble du phénomène de la guerre économique, en particulier dans la période actuelle (post-Seconde guerre mondiale).
Sapir rappelle ainsi que cette pratique remonte à l’Antiquité, illustrée par l’exemple d’Hannibal détruisant les ressources agricoles romaines lors de la seconde guerre punique afin d’affaiblir la résistance adverse. Jusqu’au XVIIIe siècle, tant que la guerre fut plus une affaire d’hommes que de matériels, la dimension financière demeurait centrale, le célèbre adage affirmant « pour faire la guerre il faut trois choses, de l’argent, de l’argent et encore de l’argent ».
À cette époque déjà, les stratégies visant à priver l’ennemi de ressources financières devient dès lors un objectif stratégique que l’on poursuit même du temps de paix. Comme en témoigne la politique de Colbert en France, favorisant la production nationale et l’exportation de produits à forte valeur ajoutée pour attirer des flux d’or et d’argent vers le royaume et en éviter la sortie. De même, les pratiques de piraterie tolérées par les grandes puissances européennes en temps de paix, puis institutionnalisées en temps de guerre sous forme de « guerre de course », étaient destinées à perturber les flux financiers ennemis, en particulier espagnols et à diminuer la capacité économique des adversaires.
Avec la Révolution industrielle, Jacques Sapir souligne que la guerre économique prend une dimension nouvelle, marquée par l’importance accrue de la logistique et de la capacité industrielle des États. L’expérience américaine lors de la guerre de Sécession, puis dans les conflits russo-turcs et russo-japonais, et plus encore dans la Première Guerre mondiale, illustre parfaitement l’industrialisation des conflits et la militarisation de l’industrie. Aux États-Unis, la création du Army Industrial College en 1924 symbolise cette prise de conscience, institution analysant non seulement les capacités nationales de mobilisation industrielle, mais aussi celles des autres puissances mondiales, préfigurant ainsi la réflexion moderne sur la guerre économique. L’Industrial College joua un rôle important tant dans l’élaboration d’une doctrine de la mobilisation industrielle que dans sa réalisation à partir de 1941.
Cependant, J. Sapir insiste sur une évolution majeure : la guerre économique ne reste plus exclusivement subordonnée à la guerre militaire. Au XIXe siècle, les théoriciens du protectionnisme moderne, notamment Friedrich List et Henry Charles Carey, développent l’idée d’une « guerre économique du temps de paix » menée indépendamment des conflits armés, visant spécifiquement à contester la suprématie économique britannique. List, exilé aux États-Unis, propose une politique de protectionnisme industriel pour permettre aux États moins développés de construire une souveraineté économique autonome, précurseur en cela des concepts modernes de protection des marchés intérieurs et de souveraineté économique. Carey, quant à lui, développe une critique virulente du libre-échange britannique, accusé de perpétuer la domination économique à travers une forme déguisée de guerre économique contre les autres nations.
Pour ces deux hommes, la Grande-Bretagne poursuit donc une guerre de domination mais par d’autres moyens, la domination de son économie. S’opposer à cette domination, permettre aux autres pays d’atteindre ce que l’on n’appelle pas encore la « souveraineté économique » devient dès lors un objectif légitime.
Ces théories protectionnistes ont exercé une influence considérable hors de leurs pays d’origine, notamment au Japon et en Russie. En Russie, la pensée de List inspire directement des acteurs majeurs comme Serge Witte et Dmitri Mendeleïev, lesquels vont élaborer des politiques économiques fondées sur l’élévation des tarifs douaniers afin de protéger et développer l’industrie nationale. De même, au Japon, les théories protectionnistes diffusées par la Meirokusha et par l’Association Nationale d’Économie contribuent à la construction d’une économie industrielle indépendante et souveraine au tournant du XXe siècle. Ainsi, le protectionnisme devient selon J. Sapir une véritable « guerre d’émancipation économique », essentielle à l’émergence de certaines grandes puissances industrielles modernes.
Dans l’époque contemporaine, J. Sapir observe que la guerre économique dépasse largement le seul cadre étatique, intégrant de nouvelles dimensions telles que les sanctions économiques, les campagnes de discrédit des industries étrangères, les pratiques institutionnalisées de contrefaçon et de lutte contre celle-ci, ainsi que la manipulation de l’information via les médias et les outils culturels comme le cinéma. Cette complexification s’accompagne d’une perte par les États du « monopole traditionnel de la violence économique », désormais partagée avec les grandes firmes internationales et parfois déléguée à des ONG ou à des officines étatiques secrètes. Les grandes entreprises peuvent ainsi utiliser des tactiques autrefois réservées aux États, amplifiant la portée et l’impact de ces pratiques. Des entreprises multinationales agissent parfois comme des quasi-États, appliquant leurs propres formes de régulations économiques et exerçant une influence sur les politiques nationales à travers le lobbying et d’autres mécanismes d’influence.
Jacques Sapir conclut ainsi que la guerre économique contemporaine repose toujours fondamentalement sur la volonté des États de préserver leur souveraineté économique tout en affaiblissant celle de leurs concurrents. À travers diverses pratiques telles que la maîtrise des secteurs stratégiques, le contrôle des investissements étrangers, l’attraction de talents et d’entreprises étrangères, ainsi que la création de dépendances structurelles réelles ou perçues, cette guerre économique demeure un enjeu central pour renforcer la position stratégique des nations sur la scène mondiale, souvent au détriment de la coopération internationale et du multilatéralisme.
2ème table ronde : les machines de guerre économique
La deuxième séquence animée par Nicolas Moinet, réunissait Christian Harbulot, le professeur Jean-Philippe Eiglinger et Ali Moutaïb
La puissance dans la guerre économique « du temps de paix »
Selon Christian Harbulot, la compréhension d’un concept est facilitée par l’officialisation de sa dimension stratégique sur la scène internationale. C’est le cas pour « l’économie de guerre » comme pour la guerre économique « du temps de guerre ». Mais ce n’est pas le cas pour la « guerre économique du temps de paix ».
Cela relève pour lui d’un chaînon manquant de l’étude de la guerre économique. Les deux guerres mondiales du XXe siècle ont démontré l’importance des moyens logistiques pour soutenir l’action des forces armées. L’invasion d’une partie du territoire ukrainien par la Russie a réactualisé cette perception de la dimension stratégique de « l’économie de guerre » dans le fonctionnement d’un pays. C’est notamment la capacité à supporter un choc de haute intensité qui a incité des politiques à s’interroger sur les moyens pour y parvenir. En France, le débat produit au Sénat[15] par la nouvelle Loi de Programmation militaire a souligné l’insuffisance des munitions et les difficultés, faute de volonté politique suffisante au cours des vingt dernières années, à penser l’utilité d’une « économie de guerre ». Comme le rappelle la Fondation pour la Recherche Stratégique[16], la poursuite d’une guerre majeure sur le flanc de l’Europe a conduit depuis deux ans les autorités politiques à évoquer la nécessité de définir les axes stratégiques d’une politique industrielle à la hauteur de nos besoins.
Dans un passé encore plus lointain, la guerre économique « du temps de guerre » a donné lieu à une réflexion stratégique notamment pour lutter contre la contrebande de guerre[17]. En février 1909, la déclaration relative au droit de la guerre maritime a été définie lors d’une conférence à Londres. Son article 24[18] liste les objets et matériaux considérés comme contrebande de guerre et susceptibles de servir aux usages de la guerre comme à des usages pacifiques, et compris sous le nom de contrebande conditionnelle. Alimentée par le bilan des pratiques allemandes lors de la première guerre mondiale, la question des pays neutres qui usent de leur statut pour servir de transit au commerce illicite avec des pays impliqués dans un conflit, a une pris dimension stratégique majeure comme l’analyse René Cassin[19] à l’aube de la seconde guerre mondiale.
Mais qu’en est-il, souligne Christian Harbulot, du niveau de perception stratégique concernant la guerre économique « du temps de paix », troisième pièce constitutive du concept de guerre économique ? Force est de constater que nous abordons là une sorte de trou noir. Aucun Etat n’a pris de position officielle sur le sujet. Il est en de même pour les conférences internationales du type Davos[20] ou G20[21]. Ce thème de réflexion ne figure pas pour l’instant à leur programme. Comment peut-on expliquer un tel « oubli » ?
La seconde partie de la définition de la guerre dans le dictionnaire de l’Académie Française[22] légitime cependant la nécessité d’une réponse à cette question :
« Par extension. Affrontement organisé qui oppose des nations ou des groupes humains par d’autres moyens que la force armée. Guerre économique, commerciale. Guerre révolutionnaire ou subversive, par laquelle on suscite ou exploite des mouvements insurrectionnels pour affaiblir un adversaire. Guerre des ondes, des communiqués, qui utilise les organes d’information. Guerre psychologique, propagande visant à affaiblir le moral de l’adversaire ».
La relation entre la notion de puissance et la guerre économique « du temps de paix ». Les limites des acquis résultant des victoires militaires[23] sont une incitation pour se pencher sur les autres moyens de préserver ou d’accroître la puissance d’un pays en dehors du recours à la guerre strictement militaire. Les expériences historiques qui nous guident dans cette recherche sont très différentes selon les contextes.
Le contexte européen a été précurseur en la matière. La confrontation entre la France et les monarchies européennes après la Révolution de 1789 a engendré des pratiques de guerre économique qui sortaient du cadre de « l’économie de guerre » ou de la « guerre économique en temps de guerre ». Afin de rattraper le retard accumulé par rapport à la Révolution industrielle britannique, Napoléon Ier décida de mobiliser toutes les forces non militaires afin d’acquérir la connaissance qui faisait défaut à l’infrastructure industrielle française. Il nomma un chimiste Jean Antoine Chaptal en charge du ministère de l’Intérieur pour protéger les manufactures nationales mais aussi pour impulser une nouvelle dynamique économique dans l’agriculture, le commerce et l’industrie.
Au-delà du cadre strictement étatique, il impulsa des initiatives embryonnaires de guerre économique « du temps de paix ». La fondation de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale en 1801 s’inscrivit dans l’esprit de cette nouvelle politique qui cherchait à favoriser l’innovation au service de l’intérêt national. Tous les moyens possibles furent utilisés à l’époque, y compris le recours à des ingénieurs, pour acquérir et dans certains cas piller le savoir industriel britannique : rapports d’étonnement, importation illégale de machines, espionnage industriel.
Après la défaite des armées napoléoniennes en 1815, le retour à la paix ne mit pas fin aux affrontements de nature économique entre les anciens belligérants. Le gouvernement britannique chercha à affaiblir le dispositif protectionniste[24] pour empêcher les produits des manufactures britanniques d’envahir le marché intérieur français. Londres conçut une stratégie indirecte d’influence pour mettre fin au système de défense économique mis en place par la France dans la période précédant la Restauration.
Pour atteindre cet objectif de guerre économique « du temps de paix », Londres missionna un parlementaire anglais, John Bowring[25], pour nouer des contacts sur les anciennes terres anglaises avec des entrepreneurs qui souffraient de la taxation imposée à leurs produits. Il fit publier des dizaines d’articles dans 16 journaux régionaux pour dénoncer les excès de la législation douanière appliquée dans l’hexagone. On peut mesurer les résultats de cette campagne par la réaction du ministre du commerce de l’époque, Adolphe Thiers qui accusa Bowring d’avoir mis le Sud de la France en état d’insurrection. Mais il ne faut pas perdre de vue que l’objectif de ces opérations d’influence était de faciliter l’accès des produits des manufactures britanniques au marché intérieur français.
Comme le précise Christian Harbulot, Londres missionna de nouveau John Bowring en le nommant gouverneur de Hong Kong. Ce dernier s’impliqua directement en 1856 lors de la seconde guerre de l’opium, afin de forcer la Chine[26] à s’ouvrir au commerce mondial, c’est-à-dire en premier lieu avec la Grande Bretagne.
Cette période historique combine à la fois les situations de guerre et de paix précaire. Elle illustre les trois facettes de la guerre économique :
- « L’économie de guerre » pour assurer le fonctionnement des armées.
- La guerre économique « du temps de guerre » dans la conduite des blocus continental et maritime.
- Et l’émergence d’une guerre économique « du temps de paix », matérialisée par la recherche d’une suprématie marchande britannique.
Comme le conclut Christian Harbulot, la guerre économique du temps de paix prend alors toute sa dimension démonstrative dans la définition de la puissance au-delà des effets induits par la guerre militaire.
Les machines de guerre marocaines sous ses aspects de souveraineté et d’influence
Ali Moutaïb est formateur, éditeur et expert en intelligence stratégique. Il est directeur des programmes de l’Ecole de Guerre Economique au Maroc et dirigeant du cabinet d’intelligence stratégique Hyperboree Advisors.
- Moutaib présente que dans un monde multipolaire marqué par l’intensification des confrontations économiques, la question de l’adaptation du concept de machine de guerre économique aux puissances émergentes revêt une importance capitale. Au-delà des modèles classiques de puissance économique, de nouveaux acteurs comme le Maroc bousculent les codes établis en développant des stratégies économiques adaptées à leurs réalités spécifiques.
Pour un pays en développement, une machine de guerre économique se définit comme l’orchestration coordonnée des ressources nationales pour défendre sa souveraineté économique et projeter son influence, tout en créant des leviers de puissance adaptés à ses moyens. Le cas marocain démontre la pertinence et la faisabilité d’une telle approche pour des puissances moyennes ambitieuses. En combinant stabilité politique, avantages géographiques, ressources stratégiques et vision industrielle, le Maroc a su élaborer une stratégie économique offensive qui lui permet de s’imposer comme un acteur incontournable en Afrique et au-delà.
- Moutaib s’interroge ensuite sur les fondements structurels de la stratégie marocaine. Le Royaume du Maroc s’appuie sur un ensemble d’atouts fondamentaux qui constituent le socle de sa stratégie économique. Sa position géographique, à la jonction entre l’Europe et l’Afrique, en fait un carrefour naturel pour les échanges commerciaux et une passerelle entre les continents. Cette localisation stratégique est renforcée par une stabilité politique remarquable dans une région marquée par des turbulences récurrentes, offrant un environnement favorable aux investissements et à la croissance.
Sur le plan des ressources naturelles, le Maroc détient un avantage compétitif majeur avec le contrôle de 70 % des réserves mondiales de phosphates, une ressource critique pour la sécurité alimentaire mondiale. Cette maîtrise lui permet non seulement de générer des revenus substantiels, mais aussi d’exercer une influence géoéconomique significative. Parallèlement, le pays a engagé une transition énergétique ambitieuse, visant à atteindre 52 % d’énergies renouvelables dans son mix énergétique d’ici 2030, avec des projets phares comme la centrale solaire Noor.
Les infrastructures marocaines, de classe mondiale, jouent également un rôle clé dans sa stratégie. Le complexe portuaire Tanger Med, premier port de Méditerranée et d’Afrique, classé parmi les vingt premiers mondiaux pour le trafic de conteneurs, illustre cette excellence logistique. Enfin, la diaspora marocaine, forte de plusieurs millions de membres, constitue un réseau d’influence économique et culturelle, tandis que des services de renseignement performants soutiennent la stratégie globale du pays.
Dans un second temps, A. Moutaib présente les axes stratégiques déployés par le Maroc. Le Maroc a déployé plusieurs mécanismes pour transformer ses atouts structurels en leviers de puissance économique. L’Initiative Atlantique Africaine (IAA) en est l’un des piliers majeurs. Véritable colonne vertébrale de la projection géoéconomique marocaine, cette initiative vise à créer une zone de coprospérité le long de la façade atlantique africaine, positionnant le Maroc comme hub logistique et industriel. Elle renforce également la sécurité alimentaire régionale, grâce à l’expertise de l’Office Chérifien des Phosphates (OCP), tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération avec l’Amérique latine et les Caraïbes.
Un autre projet emblématique est le gazoduc Maroc-Nigéria, qui illustre l’utilisation du soft power économique. Ce mégaprojet de 6 000 km ne se limite pas à sa dimension énergétique : il crée une coopération stratégique avec treize pays d’Afrique de l’Ouest, consolidant l’influence régionale du Maroc. En reliant les ressources gazières nigérianes aux marchés européens, il agit comme un catalyseur d’industrialisation et de développement pour les pays traversés, tout en répondant aux besoins énergétiques de l’industrie marocaine, notamment automobile.
La présence financière panafricaine constitue un troisième axe stratégique. Les institutions financières marocaines sont aujourd’hui présentes dans plus de vingt-cinq pays africains, formant un réseau d’influence économique considérable. Cette présence dépasse la simple extension géographique pour devenir un outil de projection de puissance, facilitant les investissements marocains et renforçant la coopération économique régionale.
En matière d’industrialisation, le Maroc capitalise sur ses ressources stratégiques, notamment les phosphates et le cobalt, pour s’insérer dans les chaînes de valeur mondiales des technologies d’avenir. Le secteur des batteries électriques illustre cette approche, avec l’ambition de maîtriser l’intégralité de la chaîne de valeur via un écosystème de gigafactories. Cette stratégie s’accompagne d’une politique sophistiquée d’attraction d’investissements étrangers, combinant avantages fiscaux et formation de la main-d’œuvre.
Enfin, la pandémie de COVID-19 a révélé la capacité du Maroc à basculer en économie de guerre en temps de crise. Face aux pénuries mondiales d’équipements médicaux, le pays a mobilisé son tissu industriel pour produire masques et matériel médical, démontrant une réactivité précieuse dans la gestion des chocs externes.
Le troisième point évoqué par M. Moutaib concerne les mécanismes de coordination et de mise en œuvre. Pour lui, le défi majeur pour les pays en développement réside dans la coordination efficace des différents acteurs économiques. Pour renforcer sa projection de puissance, le Maroc devra mettre en place plusieurs mécanismes clés. Actuellement, le Royaume s’appuie principalement sur son plus grand atout de soft-power, la Monarchie, comme l’illustre la tournée royale en Afrique de 2018 qui a permis d’ouvrir de nombreuses opportunités économiques. Pour amplifier cette stratégie, le renseignement économique devrait jouer un rôle central, notamment à travers la création d’une Direction Générale de la Sécurité Économique capable d’anticiper les crises et de développer des stratégies d’atténuation. La diaspora qualifiée représente également un potentiel à mobiliser davantage comme réseau d’influence, tandis qu’un système de veille stratégique plus sophistiqué pourrait être déployé sur les marchés africains ciblés par la politique Sud-Sud.
La coordination interministérielle devra être renforcée par l’instauration d’un Conseil Supérieur de la Sécurité Économique, centralisant les données et soutenant les entreprises nationales. Des task forces sectorielles public-privé devront être déployées, tandis que la diplomatie économique est activée pour négocier des accords commerciaux et protéger les investissements marocains. Les partenariats public-privé sont encouragés, notamment via la formation de consortiums pour les grands projets internationaux, intégrant des startups locales pour favoriser l’innovation. La mutualisation des ressources en intelligence économique et la mise en place de programmes de formation spécialisés complètent ce dispositif. Le retour d’expérience de L’École de Guerre Économique – campus Rabat assure la pérennité du dispositif en créant un vivier d’experts en intelligence économique adaptée au contexte africain.
Le conférencier termine en indiquant que le Maroc a transformé le concept théorique de machine de guerre économique en une réalité opérationnelle. En articulant vision stratégique, mobilisation des ressources et exploitation intelligente de ses avantages comparatifs, le Royaume a renforcé sa souveraineté économique tout en accroissant son influence régionale. Ce modèle offre des enseignements précieux pour les pays en développement : l’importance d’une vision claire, la coordination des acteurs nationaux, et une projection de puissance adaptée aux moyens disponibles. Le cas marocain prouve qu’une puissance moyenne peut, grâce à une stratégie économique offensive, transformer ses contraintes en opportunités et ses ressources limitées en leviers d’influence durable. À l’ère de la multipolarité, la maîtrise des outils de guerre économique n’est plus réservée aux grandes puissances, mais devient une nécessité pour tout État aspirant à défendre ses intérêts souverains dans un environnement international toujours plus compétitif.
Vietnam entre Diplomatie du Bambou et Guerre économique du défensif à l’offensif ?
Jean-Philippe Eglinger est spécialiste du Vietnam contemporain, expert reconnu en intelligence économique et en stratégie internationale. Maître de Conférences Associé (MAST) Enseignant – Chercheur à l’Inalco (Plidam), il a vécu plus de 15 ans à Hanoi et travaille de manière avec le Vietnam depuis plus de 30 ans. Il intervient régulièrement en tant que consultant auprès d’entreprises et d’organisations internationales sur les questions économiques, géopolitiques et sécuritaires liées à l’Asie du Sud-Est
Après une présentation méthodologique mettant l’accent sur le nécessaire travail de lecture et d’agencement de sources primaires vietnamiennes traitant du sujet et publiées par les médias officiels du Vietnam. Cette approche du pays par le « sensoriel » (langue, culture, terrain physique) permettant de « (com)prendre son point de vue » pour appréhender au plus près ses représentations est le choix assumé adopté par le conférencier afin de pouvoir opérer un « décentrage » nécessaire à une meilleure compréhension de la « source » des phénomènes étudiés afin de limiter le risque de « biais cognitif » ethnocentré de l’analyste.
Jean-Philippe Eglinger rappelle que le Vietnam approche du quarantième anniversaire de sa politique de « Renouveau » (Đổi mới), lancée en 1986. Celle-ci caractérise une voie originale de développement, combinant une intégration économique internationale rapide avec un maintien strict du contrôle politique interne. Ce choix stratégique, initié dès le VIe congrès du Parti Communiste Vietnamien, répondait initialement à une nécessité urgente : éviter un isolement économique après la disparition prévisible de l’Union soviétique. À partir des années 1990, le Vietnam a progressivement ouvert son économie aux investissements étrangers, aux échanges commerciaux internationaux et aux transferts technologiques. Cette dynamique s’est fortement accélérée au début du XXIe siècle, notamment en raison du conflit économique sino-américain, entraînant une importante relocalisation industrielle de la Chine vers le Vietnam.
Cette transformation a permis au Vietnam de connaître une croissance remarquable, avec un PIB par habitant passant de 200 USD au début des années 1990 à près de 4400 USD en 2024, positionnant le pays comme l’une des économies les plus ouvertes au niveau mondial (La valeur du commerce extérieur (importations + exportations) du Vietnam est égale en 2023 à environ 1,5 fois le PIB du pays).
Toutefois, Jean-Philippe Eglinger souligne que cette ouverture économique s’accompagne systématiquement d’une politique vigoureuse et constante de « guerre économique » par une augmentation de puissance économique aux services des autorités et de la population du pays avec pour but affiché la souveraineté nationale.
Une des composantes de cette guerre économique est la « sécurité économique », même si ce concept reste relativement peu formalisé juridiquement au Vietnam, il constitue un pilier fondamental pour la sécurité nationale, visant à garantir la stabilité économique et à protéger le pays des risques internes et externes.
Cette intégration économique s’est ainsi déroulée sous une étroite supervision politique et sécuritaire. Le Vietnam a mis en place un ensemble de mécanismes de contrôle, notamment la concentration des investissements étrangers dans plus de 500 zones économiques spéciales clairement délimitées et gérées par les autorités politiques et administratives centrales et locales.
Par ailleurs, les autorités tentent constamment de réduire leur dépendance économique vis-à-vis de partenaires extérieurs spécifiques, notamment envers la Chine (déficit de la balance commerciale) et les Etats-Unis (forts excédents de la balance commerciale) qui cependant exercent une forte pression sur l’économie vietnamienne. De plus, le gouvernement vietnamien s’appuie fortement sur les Vietnamiens résidant à l’étranger, sollicitant leurs ressources financières, techniques et relationnelles pour renforcer l’économie nationale.
Jean-Philippe Eglinger indique que dès les années 1990, une doctrine de sécurité économique a été mise en place par les autorités vietnamiennes, adoptant une approche pragmatique et essentiellement défensive. La sécurité économique est la matérialisation d’un politique d’Etat visant à protéger et à promouvoir les intérêts stratégiques d’une nation. Dans son volet défensif, la sécurité économique regroupe les activités suivantes protection du patrimoine, délimitation des périmètres industriels et technologiques critiques et la lutte contre les activités de renseignement économique étrangères. Dans une perspective offensive, il s’agit notamment d’accompagner le développement à l’international des firmes.
Des dispositifs juridiques et institutionnels précis ont été établis afin de protéger les secteurs économiques jugés stratégiques, tels que l’énergie, la défense ou les télécommunications. Cela s’est traduit par la création de grandes entreprises publiques puis par l’émergence de puissants groupes privés, étroitement liés au pouvoir politique et surnommés « capitalistes rouges vietnamiens ». Cette économie de marché dite « à orientation socialiste », désormais inscrite dans la Constitution depuis 2013 en son article 51, consacre le rôle central et moteur de l’État dans les secteurs vitaux, restreignant de facto l’accès à ces marchés aux acteurs privés tant nationaux qu’étrangers.
Par ailleurs, J-P Eglinger observe que cette politique s’appuie sur un cadre juridique solide, renforcé continuellement par des directives politiques telles que la Directive 05-CT/TW (14 octobre 2006) ou la Résolution n° 51-NQ/TW du 5 septembre 2019 du Politburo sur la stratégie de protection de la sécurité nationale. Ces textes visent à combattre les menaces potentielles à la souveraineté économique, qu’elles proviennent de l’extérieur ou de l’intérieur du pays. À cela s’ajoute la mobilisation grandissante de l’industrie nationale de défense, dont le groupe Viettel constitue un exemple emblématique. Ce dernier est devenu un acteur majeur dans le secteur technologique tant civil que militaire, illustrant l’évolution d’une stratégie désormais plus offensive de sécurité économique. La récente Loi sur la défense nationale et la mobilisation industrielle (2024), qui instaure un fonds spécifique dédié aux projets stratégiques dans les domaines de la défense et de la sécurité, confirme cette tendance.
La compétition informationnelle mise en place par le Vietnam pour accompagner son développement économique est importante. Elle joue sur les valeurs traditionnelles vietnamiennes (éducation, respect,) ainsi que sur les qualités reconnues des travailleurs (formés, travailleurs, méticuleux, …) et sur les paysages du Vietnam. N’hésitant pas à produire et faire perdurer quelques stéréotypes répondant aux représentations de forgées depuis l’étranger : Indochine, les chapeaux coniques, el Dorado, petite Chine au niveau économique… Ceci permettant de mettre un filtre entre la perception étrangère et la réalité vietnamienne.
Le contrôle des infrastructures critiques et la gestion de la cybersécurité ont également été renforcés par des réglementations rigoureuses. Par exemple, le décret 147/2024/ND-CP impose aux entreprises étrangères opérant au Vietnam l’obligation de stocker localement les données collectées, révélant une volonté explicite de maintenir une souveraineté nationale forte sur les données et les flux informationnels.
Cependant, J-P Eglinger note que les défis principaux auxquels le Vietnam est confronté résident désormais dans l’équilibre difficile entre les impératifs du pouvoir central et les besoins de développement économique des provinces, très dépendantes d’investissements étrangers croissants, notamment en provenance de Chine. Cette dépendance constitue un risque pour la sécurité économique du pays, augmentant les possibilités d’ingérence extérieure.
Face à ces risques, le Parti Communiste Vietnamien intensifie son contrôle interne sur les cadres politiques et économiques, visant à prévenir les dérives idéologiques, la corruption ou les infiltrations hostiles. La réaffirmation continue de l’importance centrale du développement économique combiné à un impératif sécuritaire rigoureux constitue ainsi un élément crucial de cette stratégie. La « pensée du PCV pourrait se résumer à ce slogan : « le développement économique reste au cœur des préoccupations du Parti et son édification impérieuse passe par le renforcement de la défense et de la sécurité nationales est une tâche clé et permanente. Pour se faire, il est nécessaire de procéder à une imbrication forte de l’économie avec la défense, la sécurité ».
Enfin, J-P Eglinger souligne que cette politique requiert nécessairement une participation active de la population. Les citoyens sont appelés à contribuer directement à la sécurité économique nationale, notamment en dénonçant les activités illicites et en surveillant les risques.
En conclusion, selon J-P Eglinger, les résultats recherchés de la gestion de l’État sur la sécurité et l’ordre dans le domaine économique ont pour but de contribuer à améliorer le système juridique, les mécanismes de gestion, les politiques, l’environnement des investissements et des affaires, à construire une économie de marché de plus en plus synchrone, à établir des liens avec les marchés régionaux et mondiaux, à amener le pays dans une intégration économique durable et approfondie, à créer le postulat de la promotion de l’industrialisation et de la modernisation du pays à l’avenir, tout en restant fermement arrimé aux principe de l’économie de marché à orientation socialiste dans un monde où les pays démocratiques semblent traverser une crise « existentielle ».
Ainsi l’association vietnamienne d’une ouverture économique maîtrisée avec une stratégie rigoureuse de sécurité économique offre un modèle original de développement étatique sous contrôle politique fort. Cette approche permet au Vietnam de renforcer durablement sa puissance économique dans le but d’affirmer sa souveraineté ; objectif rendu plus impérieux et difficile dans un contexte international de concurrence accrue entre grandes puissances économiques et technologiques.
1er grand témoin : entretien avec un « assassin économique »
Les organisateurs ont diffusé un entretien entre John Perkins, Nicolas Moinet et Arnaud de Morgny, enregistré le 26 mai 2024.
John Perkins est un économiste et auteur américain mondialement connu pour avoir écrit « confession d’un assassin financier » qui dans ces trois éditions a été vendu à plus de 3 millions d’exemplaires et traduit dans presque 40 langues.
Dans cet entretien J. Perkins raconte son passé « d’assassin économique » et Il sait très bien de quoi il parle car selon ses propres termes : « j’ai été moi-même un assassin économique. »
En 1968, à l’aide d’un contact dans la National Security Agency (NSA), il se joint aux Corps de la paix, une agence fédérale américaine indépendante qui envoie des volontaires aux quatre coins du monde pour aider des peuples étrangers à se développer. A la fin de cette expérience, il est recruté dans une société de conseil d’un type particulier : elle est chargée de monter des opérations de guerre économique en utilisant les institutions financières internationales.
Selon lui, les assassins économiques sont des professionnels grassement payés qui escroquent des milliards de dollars à divers pays du globe. Ils dirigent l’argent de la Banque mondiale, de l’Agence américaine du développement international (US Agency for International Development – USAID) -ce qui donne une autre dimension aux décisions américaines récentes- et d’autres organisations « humanitaires » vers les coffres de grandes compagnies et vers les poches de quelques familles richissimes qui contrôlent les ressources naturelles de la planète, toujours selon ses propres termes.
Leurs armes principales sont réunies en 4 piliers :
- Des rapports financiers frauduleux afin de créer les justifications d’emprunts qui vont au-delà des capacités de remboursement des pays et donc les contraignent à vendre leurs ressources premières, à accepter de privatiser leurs services publics au bénéfice d’entreprises américaines ou à accepter la construction de bases militaires américaines,
- Des élections truquées afin de faire parvenir au pouvoir ou de maintenir au pouvoir des acteurs en phase avec les intérêts soit des Etats-Unis soit de compagnies américaines
- Des techniques de même nature que celles utilisées par la mafia : la corruption, l’extorsion, la compromission sexuelle- ce qui relève du chantage-.
- Enfin le meurtre organisé par ce qu’il appelle les « chacals ».
L’intérêt de ce témoignage est qu’il évoque une dimension rarement étudiée de la guerre économique : la guerre économique entre Etats par le truchement d’organisations internationales. Les études de cas traitent souvent de guerres économiques dans le secteur privé entre entreprises et parfois de guerres économiques entre entreprises ou secteurs économiques soutenus par des Etats quasiment jamais de guerre économique directement entre Etats.
3ème table ronde : comment certains Etats ont-ils résisté à des actions de guerre économique de forte intensité ?
Cette séquence animée par Nicolas Moinet réunissait les professeurs Mehrdad Vahabi et Dmitri Kuvaline.
Sanctions et capitalisme politique : le cas iranien
Mehrdad Vahabi est professeur d’économie à l’Université Sorbonne Paris Nord et habilité à diriger des recherches. Il dirige le Centre d’économie Paris Nord-CEPN, une filiale du CNRS.
Dans sa présentation « Sanctions and Political Capitalism : The Iranian Case » (Sanctions et capitalisme politique : le cas iranien), le pr. Vahabi étudie l’inefficacité paradoxale des sanctions économiques, pourtant de plus en plus fréquentes, sous l’angle du capitalisme politique, et plus particulièrement celui de l’Iran.
Les théories économiques conventionnelles, telles que formulées par Murray C. Kemp, supposent que les sanctions infligent des pertes de bien-être qui obligent les pays cibles à les respecter et ainsi à se soumettre à l’injonction qui en est l’origine. Cependant, la recherche empirique, comme le soulignent des chercheurs tels que Hufbauer et al, suggère que les sanctions atteignent rarement les résultats politiques escomptés et que leur efficacité diminue considérablement après environ trois ans.
Vahabi résout ce paradoxe en affirmant que les sanctions contemporaines sont devenues des instruments du capitalisme politique, où le commerce et la finance sont martialisés, brouillant les objectifs commerciaux et politiques. En particulier après 2000, les sanctions sont allées au-delà des simples embargos, notamment illustrés par les politiques américaines telles que FIRRMA et ECRA, transformant la guerre économique en une entreprise rentable pour les groupes politiques et commerciaux influents dans les pays émetteurs et récepteurs.
Cette martialisation ou politisation du commerce est ce qu’il explique en termes de « capitalisme politique ». La distinction entre le capitalisme politique et le capitalisme de marché a été initialement formulée par Max Weber (1905/1985, 1922/1978). Alors que le capitalisme de marché fait référence à la réalisation de profits monétaires par le biais de marchés concurrentiels (échanges de marchandises ou de devises, production industrielle par des sociétés modernes, etc.), le capitalisme politique est fondé sur la réalisation de profits monétaires par des canaux non marchands, en particulier l’utilisation de moyens politiques à des fins de recherche de rente. Selon Weber, le capitalisme politique précède le capitalisme moderne du XIXe siècle et remonte à l’Antiquité et au Moyen Âge. Il a notamment souligné l’importance du capitalisme politique dans les empires romain et chinois en temps de guerre et a suggéré que la chute de l’empire romain était due au rôle déstabilisateur du capitalisme politique.
Appliquant cette perspective à l’Iran, M. Vahabi établit une distinction entre les sanctions traditionnelles (antérieures à 2000) visant à limiter l’influence régionale et les « sanctions intelligentes » plus sophistiquées, postérieures à 2000, qui ciblent principalement les institutions financières et les exportations de pétrole. Il identifie deux périodes de pointe des sanctions – 2011-2014 sous Ahmadinejad et 2018-2019 sous l’administration Trump – brièvement interrompues par l’accord JCPOA en 2015.
Les analyses économétriques utilisant des méthodes structurelles vectorielles autorégressives (SVAR) et des méthodes de contrôle synthétiques (SCM) estiment que l’Iran a subi des pertes économiques substantielles. Entre 2011 et 2022, les sanctions ont entraîné une baisse globale du PIB d’environ 15 à 20 %, dépassant les coûts économiques de la guerre Iran-Irak. Les sanctions financières ont été particulièrement efficaces et ont eu un impact inégal sur les différents secteurs, exacerbant les vulnérabilités dans les zones rurales, les groupes à faibles revenus, les moins éduqués et les groupes d’emploi féminins.
Néanmoins, les sanctions ont aussi involontairement renforcé le capitalisme politique chiite de l’Iran, notamment par le biais du principe de l’Anfal, une construction théologique affirmant les droits exclusifs de propriété du Guide suprême sur les biens non réclamés ou confisqués. Cette doctrine justifie la création de holdings géants islamiques (Bonyad, Setad, Khatam al-Anbiya, Astan Qods Razavi) qui contrôlent plus de 60 % de l’économie iranienne sous le contrôle du guide suprême Khamenei. Ces institutions, non soumises à l’État, bénéficient directement des sanctions, en accaparant les ressources abandonnées par les entreprises étrangères.
Ce système institue un capitalisme politique chiite fondé sur la confiscation légale de biens, la fusion du pouvoir politique et de la propriété, la prédation économique, aux dépens de la production, la domination d’une oligarchie religieuse et militaire.
Vahabi théorise ainsi un « triangle impossible » entre l’Anfal (institutions islamiques de propriété exclusive), la privatisation et l’ouverture économique (notamment aux investissements occidentaux). Selon lui, il est impossible de combiner ces trois éléments. À chaque époque politique de l’Iran correspond un équilibre instable. Sous Rafsanjani : ouverture + Anfal → échec de la privatisation. Sous Ahmadinejad : Anfal + privatisation → fermeture économique. Sous Khatami : privatisation + ouverture → affaiblissement d’Anfal.
Par conséquent, les sanctions durables deviennent des instruments qui ne visent pas principalement à faire respecter les règles, mais qui sont plutôt perpétués par les intérêts mutuels des factions politiques capitalistes des nations émettrices et réceptrices. Pour l’Iran, les sanctions ont créé un environnement favorable à l’approfondissement du capitalisme politique chiite, renforçant le contrôle économique des institutions religieuses et paramilitaires étroitement liées aux élites politiques, transformant ainsi une supposée punition économique externe en un catalyseur pour la consolidation interne du pouvoir.
En d’autres termes, selon M. Merhdad, le paradoxe des sanctions ne peut être résolu que s’il existe des groupes d’intérêts majeurs dans les pays « émetteurs » et « récepteurs » qui peuvent tirer profit des sanctions. Dans de telles circonstances, les émetteurs et/ou les récepteurs auraient intérêt à trouver un équilibre qui perpétue la guerre économique en tant que moyen de réaliser des profits. La « résilience » n’est alors rien d’autre que des intérêts tacites partagés dans le maintien d’une guerre économique de faible intensité sur une longue période. Ainsi, les ennemis peuvent parfois être des amis utiles.
L’impact des sanctions occidentales sur l’économie russe
Le professeur Dimitri Kuvaline est docteur en sciences économiques, directeur adjoint et chef du laboratoire d’analyse et de prévision des processus microéconomiques de Moscou
Le professeur Kuvaline met l’accent sur la manière dont l’économie russe a réussi à s’adapter à ces sanctions et sur les facteurs qui ont contribué à cette résilience apparente.
Le professeur souligne que contrairement aux attentes, l’économie russe affiche de bons résultats, en particulier en 2023 et au premier semestre 2024. Il met en évidence la croissance impressionnante des principaux indicateurs macroéconomiques, notamment le taux de croissance des investissements en capital fixe (près de 10% en 2023 et 11% au premier semestre 2024).
Le professeur affirme que les statistiques officielles sont corroborées par les données collectées par son laboratoire auprès des entreprises russes. Il cite une enquête montrant une forte accélération des projets d’investissement en production en 2024, avec 64% des répondants déclarant en réaliser actuellement.
Les intentions d’investissement des entreprises russes montrent également une tendance à la hausse claire en 2024.
Selon lui l’économie russe a traversé de nombreux chocs au cours des 30 dernières années, développant une expertise dans leur gestion. Le professeur compare l’économie russe à un « athlète très entraîné » à résister aux chocs. Il note que le choc de la pandémie de COVID-19 a été perçu comme plus fort que les sanctions internationales par les entreprises.
Ces dernières ont privilégié des méthodes d’adaptation actives (recherche de nouveaux fournisseurs et marchés, modernisation) plutôt que passives (licenciements, réductions de salaires et d’investissements).
La limitation imposée des exportations de capitaux a conduit à une réorientation des fonds vers l’économie intérieure, fournissant un soutien financier nécessaire après une période de pénurie.
Le professeur affirme que le choix de ne pas résoudre les « problèmes militaires » en réduisant le niveau de vie a permis de limiter les tensions sociales et de maintenir le soutien aux processus économiques. Le professeur affirme même que selon les chiffres, la qualité de vie s’améliorerait.
Certains facteurs additionnels favorisent l’adaptation de l’économie russe aux pressions extérieures. L’expansion significative du commerce avec les pays amis et neutres a compensé les pertes liées au retrait des marchés occidentaux. L’augmentation de la production militaire a eu un impact positif important sur plusieurs secteurs (mécanique, microélectronique, IT) y compris non-militaires. Il y eut aussi l’apparition de niches de marché (effet d’aubaine) après le départ de certaines entreprises occidentales : les entreprises russes ont pu se développer plus rapidement dans divers secteurs (agriculture, agro-alimentaire, chimie, IT, tourisme). Certaines politiques d’anticipation ont diminué les impacts de certaines décisions occidentales.
Le professeur Kuvaline se félicite de ce qu’il appelle des « histoires de succès » Ainsi la création anticipée du système de paiement national (Mir) en remplacement de SWIFT a permis de passer du jour au lendemain d’un système à l’autre ou bien la politique de développement du réseau de transport pour le commerce extérieur (ports, chemins de fer) a facilité une réorientation vers d’autres partenaires. S’y ajoutent des mesures de soutien sectoriel du gouvernement fédéral (construction, agriculture, IT, tourisme, PME) dans le but d’accompagner la transition vers une économie sous sanction.
Un autre facteur favorable fut la hausse des prix mondiaux de certaines exportations russes en 2022 : Gaz, charbon, métaux non ferreux, engrais minéraux.
Une autre forme d’adaptation est la formation rapide d’une « flotte fantôme » de navires non identifiés pour le transport de pétrole et de gaz. Il est dit qu’environ 600 navires et 50 Tankers transportent le pétrole russe et ses produits pétroliers ainsi que le gaz liquide
Il précise aussi la mise en place d’une coopération croissante avec les autres pays sous sanctions occidentales. Il donne comme exemple, la coopération économique croissante avec l’Iran et l’Afghanistan.
En ce qui concerne la fiabilité des données présentées, le professeur reconnaît que la seule source d’information sur l’inflation est l’agence statistique russe (Rosstat). Il exprime sa confiance envers les professionnels de cette agence, malgré l’absence de sources alternatives.
Sur les risques qui existent pour l’économie russe, il précise qu’en cas de tensions économiques avec la Chine, il identifie deux problèmes majeurs pour les producteurs russes dans ce scénario : la réduction de l’accès aux technologies de pointe, la dépendance potentielle à un partenaire unique. Il estime que les partenaires chinois pourraient substituer une partie des technologies de pointe, mais pas plus de 60 à 70%. L’accès aux technologies critiques reste un défi majeur que la Russie devra surmonter elle-même, ce qui prendra de nombreuses années.
En ce qui concerne la confiscation des actifs russes par l’UE, le professeur estime que la Russie a déjà « perdu cet argent il y a deux ans » et que le gouvernement russe envisage ces fonds dans une perspective à long terme. Il suggère que la Russie se concentre actuellement sur d’autres potentiels plutôt que d’essayer de récupérer ces actifs immédiatement.
En conclusion, le professeur Kuvalin brosse un portrait optimiste de la capacité de l’économie russe à s’adapter aux sanctions occidentales. Il met en avant l’expérience passée du pays face aux chocs économiques, les mesures proactives adoptées par les entreprises et le gouvernement, ainsi que des facteurs externes conjoncturels et stratégiques. Cependant, la question de l’accès aux technologies de pointe et l’incertitude quant à la concurrence future de ses partenaires soulignent des vulnérabilités potentielles à long terme. La dépendance aux données statistiques nationales pour l’évaluation de l’inflation est également un point à considérer. La réponse concernant la confiscation des actifs suggère une reconnaissance de la perte, mais une focalisation sur les opportunités économiques présentes et futures.
2ème grand témoin : la guerre économique dans le secteur de la plasturgie
Joseph Tayefeh est le Secrétaire Général du syndicat Plastalliance, une organisation interprofessionnelle des plasturgistes et essayiste. Il a écrit en 2023 Plastique bashing : l’intox ? (éditions Cherche Midi) qui a été traduit en anglais en décembre 2024 sous le titre Plastic Bashing :Fake news ?
Dans son intervention, il alerte sur les conséquences d’une guerre économique méconnue : celle menée contre l’industrie plastique française.
Monsieur Tayefeh souligne le rôle central de la plasturgie, au croisement d’enjeux militaires, sanitaires, humanitaires, énergétiques et agricoles, enjeux qui font de ce secteur un terrain de jeu stratégique pour la guerre économique.
Les annonces franco-françaises contre notamment les plastiques à usage unique révèlent selon lui un paradoxe : Tout en prônant une restriction de ces plastiques, le gouvernement français a prévu des dérogations massives prévues par le décret n°2022-2 du 4 janvier 2022 qui reconnaissent en réalité le caractère indispensable du plastique dans des situations critiques — sanitaires, humanitaires ou de défense. Ce double discours affaiblit les industriels qui n’ont pas de visibilité économique et stratégique sur le long terme. M. Tayefeh estime qu’en l’absence d’une industrie des plastiques à usage unique pérenne en France, cette dernière deviendra dépendante de l’étranger lors de ces situations de crise à l’image de l’épisode de la covid-19 avec les masques (qui sont en plastique).
Tayefeh illustre l’impact économique de la réglementation française par un cas concret : celui de Pascal Dupré (premier producteur français de haricots verts frais). L’application du décret issu de la loi AGEC (loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire) et interdisant les emballages plastiques pour la plupart des fruits et légumes a contraint cet agriculteur à abandonner les emballages plastiques, entraînant une cascade de surcoûts, pertes agricoles, et refus clients. Le passage au papier (fourni pour des raisons de coût par des entreprises polonaises et italiennes) — promu comme alternative — s’est soldé par une baisse de chiffre d’affaires et une mise en péril de l’entreprise, sans solution technique équivalente. L’entreprise se fournissait avant cette réglementation auprès d’un fabricant d’emballages français.
Enfin, M. Tayefeh dénonce l’influence d’acteurs étrangers, notamment la Fondation Heinrich Böll, financée par l’Allemagne, qui promeut activement des campagnes antiplastiques en France, tout en portant des messages plus larges sur la politique énergétique hexagonale. Il y voit une manœuvre stratégique visant à affaiblir l’industrie française au profit d’intérêts concurrents.
Dans le cadre du traité international visant à lutter contre la pollution plastique, le refus de réduire la production de plastique de la part de pays majeurs en termes économique, militaire ou démographiques (Etats-Unis, Russie, Chine, Inde, Afrique du Sud, pays du Golfe notamment) doit alerter selon M. Tayefeh sur les logiques de puissance à l’œuvre dans les politiques environnementales, et invite à reconsidérer le plastique comme un levier d’autonomie industrielle et de souveraineté nationale. Il conclut par cette phrase « Celui qui domine l’industrie des plastiques, domine le monde ».
4è table ronde : l’Europe, un incubateur de la guerre ECONOMIQUE ?
Cette séquence était animée par Arnaud de Morgny et réunissait Gisèle Jourda, Nicolas Ravailhe, Paolo Casaca et Pascal Legai.
Dans son intervention, la sénatrice Gisèle Jourda souligne la nécessité d’une prise de conscience accrue face aux enjeux de la guerre économique contemporaine. Elle constate initialement un paradoxe : malgré une attention croissante portée aux influences étrangères malveillantes dans les débats parlementaires français, la dimension économique demeure relativement négligée, victime notamment d’une approche trop sectorielle. Pourtant, Mme Jourda rappelle que les enjeux de souveraineté industrielle, énergétique, numérique et alimentaire sont devenus centraux dans le débat public.
Tout en saluant le rapport de 2023 du Sénat intitulé « Reconquérir notre souveraineté grâce à l’intelligence économique », et en particulier Marie-Noëlle Lieneman la corapporteure, elle considère cette initiative encore trop isolée dans le paysage politique français. Gisèle Jourda, membre des Commissions des Affaires étrangères et européennes, met alors en avant ses propres travaux réalisés avec le sénateur Pascal Allizard sur la mobilisation européenne face à la puissance chinoise, afin d’illustrer le rôle potentiel de l’Europe comme incubateur ou victime de la guerre économique.
Le premier rapport, rédigé en 2017, interrogeait la stratégie chinoise des « nouvelles routes de la soie », questionnant si elles représentaient uniquement un projet économique ou l’amorce d’un nouvel ordre mondial. Le rapport alertait déjà sur le manque de réciprocité, l’insuffisance du respect environnemental, ainsi que les risques liés au piège de l’endettement découlant d’une politique chinoise opaque, mêlant investissements, dons et prêts. Jourda regrettait à cette époque une réponse européenne jugée insuffisante face à ces défis majeurs.
Le second rapport, publié en 2021, souligne l’évolution rapide de la situation : la Chine ne se présentait plus comme un acteur économique émergent mais comme une puissance mondiale établie. La présence chinoise en Europe est alors décrite comme significative, diversifiée, et parfois dissimulée. La pandémie de coronavirus a accentué les perceptions négatives de cette influence, mettant en lumière à la fois la dépendance économique de l’Europe à l’égard de la Chine et les nouvelles formes affirmées de diplomatie chinoise (« diplomatie des masques », « Loups combattants »).
Gisèle Jourda souligne toutefois une évolution positive : une prise de conscience plus aigüe des acteurs européens dès 2021, malgré une simplification excessive du discours européen face à la Chine, résumée par le triptyque « partenaire, concurrent, rival systémique ». Les rapporteurs proposent ainsi quatorze recommandations, structurées autour de quatre axes principaux : premièrement, contrer les moyens déployés par la Chine en Europe ; deuxièmement, répondre à son avance technologique ; troisièmement, élaborer une stratégie géopolitique appropriée face aux ambitions chinoises du XXIe siècle ; et quatrièmement, construire une relation commerciale plus équitable avec Pékin.
Pour la sénatrice, il est impératif d’abandonner toute naïveté face à la puissance chinoise et d’affirmer une politique européenne forte, autonome, capable de résister aux pressions chinoises mais aussi américaines. Elle déplore notamment la difficulté à maintenir l’unité européenne face aux stratégies agressives bilatérales de Pékin, comme illustré par la visite solitaire du chancelier allemand Olaf Scholz en Chine en novembre 2022, refusant la proposition du président Macron d’y participer conjointement.
Enfin, la sénatrice appelle à une réflexion approfondie et collective sur les instruments européens actuels destinés à contrer les stratégies économiques agressives de la Chine, tout en interrogeant leur efficacité et leur suffisance face aux défis contemporains. Ces problématiques feront, selon elle, l’objet d’un troisième rapport, dont elle s’engage à rendre compte prochainement.
L’Europe : incubateur et accélérateur de la guerre économique !
Nicolas Ravailhe est avocat, Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles et enseignant à l’école de guerre économique.
Dans son intervention Nicolas Ravailhe affirme que l’Union européenne (UE) agit non seulement comme incubateur mais aussi comme accélérateur de la guerre économique actuelle.
D’emblée, Ravailhe rappelle l’aversion traditionnelle de l’UE pour la géopolitique, préférant lui substituer une approche géo-économique. Cette préférence explique la rareté de l’usage officiel du terme de « guerre économique » en Europe, visant à ne pas alarmer l’opinion publique tout en occultant la réalité d’une concurrence intense entre États membres, notamment de la part des puissances économiques dominantes comme l’Allemagne et les Pays-Bas.
En ce qui concerne la guerre économique intra-européenne, N. Ravailhe souligne que celle-ci est intrinsèquement liée à l’existence même du marché intérieur, fondé sur les libertés de circulation des capitaux, des biens, des services et des personnes. Il attribue à Werner von Siemens la conceptualisation initiale de cette dynamique, en citant la phrase qui lui est attribuée : « qui crée la norme, crée le marché ». Selon N. Ravailhe, la France a longtemps sous-estimé ou mal compris cette logique stratégique, ce qui explique son recul économique marqué par un déficit commercial intra-européen passé de 19 milliards d’euros en 2002 à 149 milliards d’euros en 2022. En comparaison, les Pays-Bas ont vu leur excédent croître considérablement pour atteindre 326 milliards d’euros durant la même période.
Ravailhe indique également que l’Union européenne est fortement influencée par l’ordo-libéralisme des pays d’Europe du Nord, imposant ainsi des modèles économiques et juridiques qui bénéficient en priorité à certains États membres, en particulier l’Allemagne. Celle-ci, en tant que contributeur net au budget européen, a efficacement utilisé les fonds européens pour développer ses entreprises en Europe de l’Est, assurant ainsi des gains substantiels sans sacrifier son emploi intérieur. Cette stratégie a néanmoins entraîné une perte de souveraineté économique significative pour ces pays, malgré une augmentation relative de leur PIB.
En revanche, Ravailhe critique sévèrement la France, dénonçant un phénomène de « pillage » systématique organisé par des cabinets-conseils au service d’entreprises étrangères, qui exploitent habilement les fonds européens disponibles en France pour neutraliser toute concurrence nationale potentielle. Il relève en outre les succès notables de l’Italie dans l’obtention et l’exploitation de ces mêmes fonds, contrairement aux préjugés couramment véhiculés en France.
À l’échelle internationale, Ravailhe observe que l’UE associe fortement la notion de puissance à ses excédents commerciaux, rejetant l’idée traditionnelle de souveraineté économique au profit de celle de résilience économique. Cette approche vise à éviter des représailles économiques tout en préservant une certaine indépendance technologique dans des secteurs stratégiques comme celui des semi-conducteurs.
Dans ses relations avec les États-Unis, l’Europe maintien des excédents commerciaux significatifs dans le commerce des biens (158 milliards d’euros en 2023), tempérés cependant par un déficit important dans les services (100 milliards d’euros). N. Ravailhe souligne néanmoins la disparité des bénéfices au sein même de l’UE, l’Allemagne, l’Italie et l’Irlande étant particulièrement favorisées, l’Irlande bénéficiant surtout de l’implantation d’entreprises américaines attirées par le dumping fiscal.
Quant aux relations commerciales avec la Chine, N. Ravailhe distingue deux stratégies européennes concurrentes. D’un côté, les Pays-Bas et la Belgique importent massivement des biens chinois pour les revendre en Europe, ce qui constitue une source majeure de désindustrialisation pour la France, confrontée à une concurrence jugée déloyale. De l’autre côté, l’Allemagne produit et exporte massivement vers la Chine, utilisant stratégiquement ses importations chinoises comme intrants pour renforcer sa position commerciale mondiale, ce qui irrite particulièrement les États-Unis, soucieux de diviser les Européens sur cette question, notamment par le biais de la thématique des droits humains.
En conclusion, N. Ravailhe appelle à une prise de conscience urgente en France, préconisant une rupture avec une approche défensive inefficace au profit d’une stratégie offensive coordonnée, impliquant tous les acteurs économiques : publics, privés et territoriaux. Il insiste particulièrement sur l’importance de soutenir activement les PME et sur le rôle essentiel que les territoires peuvent jouer dans cette dynamique. Enfin, il rappelle les atouts réels de la France, tels que la productivité du travail, tout en alertant sur la nécessité d’agir rapidement afin de préserver le pacte social français menacé par la dégradation économique régionale relative.
Compétition économique entre Etats Membres européens au sein de l’agence spatiale européenne, l’impact du retour géographique
Le général de division aérienne Pascal Legai est un officier de renseignement de l’armée de l’air et de l’espace. Il exerce les fonctions de Conseiller Sécurité du Directeur Général de l’agence spatiale européenne depuis 2021.
Selon le général Legai, les Etats Membres de l’UE et de l’ESA (sigle anglais de l’agence spatiale européenne) défendent avant tout les intérêts nationaux et souverains avant l’intérêt collectif pour notamment permettre aux entreprises nationales de rester compétitives tout en de bénéficiant des avantages des mécanismes européens divers de soutien. A ce titre, le mécanisme du “retour géographique” de l’Agence Spatiale Européenne, constituant fondateur de l’Agence, est aujourd’hui remis en cause, plus particulièrement par la France, car considéré désormais comme un frein à la compétitivité. L’adapatation du “Georeturn” à l’évolution du contexte économique apparaît nécessaire pour faire face aux méthodes agressives de la concurrence non-européenne.
Pour le général, le mécanisme du retour géographique est le modèle de gouvernance choisi par les Etats Membres de l’ESA, à la création de l’ESA en 1975, en permettant à tous les Etats Membres d’accroître leur niveau scientifique et technologique dans le domaine spatial en soutien des entreprises nationales.
Il signifie essentiellement que les investissements réalisés par chaque État Membre de l’ESA dans les activités de l’Agence doivent générer des retombées économiques au niveau national. Ce principe encourage les États Membres à investir dans la technologie spatiale et le développement d’infrastructures en s’assurant qu’ils reçoivent des avantages tangibles en retour, tels que des contrats pour la fabrication de satellites, des services de lancement, le développement d’infrastructures au sol et d’autres activités connexes.
Au bilan, le retour géographique dans les pratiques de passation de marchés de l’ESA, a contribué à créer un écosystème dynamique et compétitif de l’industrie spatiale européenne, à réduire les coûts des missions spatiales européennes grâce à une culture de la concurrence accrue, en tirant parti des atouts de ses États Membres par une expansion du marché et une base de fournisseurs diversifiée, en encourageant les entreprises à innover, à développer des technologies et des processus plus efficaces, par la collaboration et le partage des coûts.
l’ESA a ainsi été en mesure de réaliser des missions spatiales plus rentables tout en générant des retombées économiques pour ses États Membres.
Cependant, le retour géographique bénéficie à des entreprises parfois non compétitives, à des fournisseurs qui ne répondent pas aux exigences du marché, surtout pour les programmes d’importance comme les lanceurs ou des constellations significatives de satellites. Le modèle du “georeturn” est donc à changer, ou tout au moins à adapter.
Le général Legai revenant sur le contexte international en pleine évolution indique que celui-ci impose une adaptation du retour géographique.
En effet, l’espace s’affirme comme un enjeu économique, industriel et technologique majeur. L’avènement des acteurs privés a conduit à ouvrir l’accès à l’espace, à l’utilisation des données spatiales, en particulier d’observation de la Terre, ouvrant de nouveaux marchés et services, par exemple dans la gestion des crises environnementales ou l’internet des objets (IoT). En outre, l’évolution des contextes géopolitique et géoéconomique remet en question l’idée que l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique est « l’apanage de l’humanité toute entière ». Dès lors, la libéralisation continue du secteur spatial soulève la question d’un accès plus équitable et durable aux ressources et aux activités spatiales. IL ajoute que la compétition stratégique croissante entre nations pour la maîtrise de l’espace, caractérisée par le développement de technologies et de capacités militaires spatiales sensibles, notamment anti-satellitaires, conduit à une remise en cause d’un usage pacifique de l’espace qui devient un milieu dans lequel la confrontation apparaît imminente.
L’Europe connaît aussi des évolutions de grande ampleur, caractérisées par la montée en puissance de concurrents au sein de l’écosystème spatial européen qui investissent progressivement tous les champs de compétences technologiques que détenaient seules un nombre très limité d’Etats dont principalement la France (lanceurs, télécommunications, navigation/positionnement, observation de la Terre, chiffrement, surveillance de l’Espace…). Des tensions importantes sont apparues en 2022/2023, en particulier sur la question des lanceurs (surcoûts et retard Ariane 6, séparation entre Avio et Arianespace).
En parallèle, l’Union européenne s’affirme comme un acteur essentiel, avec la contractualisation en décembre 2024 de la constellation souveraine IRIS.
Dans le domaine des lanceurs, le sommet de Séville de 2023 a permis de garantir l’accès à l’espace pour l’Europe par le soutien aux lanceurs Ariane 6 et Vega-C, tout en marquant le début du « Vexit » (la société italienne Avio, maître d’oeuvre industriel dans le secteur spatial, récupèrera ainsi la commercialisation de la fusée Vega-C au détriment d’Arianespace). L’Allemagne a soutenu avec succès l’adoption d’un modèle de concurrence par les opérateurs de lancement, tout en soulevant les questions de la définition précise des critères de sélection et de l’accès aux technologies développées par l’ESA. Enfin, la question du contrôle aéroportuaire du Centre spatial guyanais (CSG), centre européen d’opération des lanceurs pour l’ensemble des pays membres, devient déterminante.
L’ensemble de ces dynamiques ont un impact très fort sur la nature des activités dans l’espace, incitent à repenser ces domaines stratégiques majeurs que sont l’accès à l’espace et le futur des lanceurs ; les sciences de la Terre et de l’Univers ; l’exploration habitée ; les télécommunications spatiales ; le renseignement, les services en orbite et l’action opérationnelle dans, vers et depuis l’espace ; la consolidation de la filière industrielle – dont l’intégration des acteurs du New Space – et des compétences ; la gouvernance du spatial au niveau Européen est à revoir entre la Commission européenne, EUSPA, l’ESA, les Etats Membres, le futur du programme spatial européen, la sécurité et la résilience des infrastructures spatiales, l’environnement et la congestion des orbites, les coopérations internationales, avec les Etats-Unis plus particulièrement.
Pour conclure, le général Legai précise que l’Europe ne pourra faire face à ses compétiteurs internationaux que si elle est unie, en dépassant l’intérêt national toutes les fois qu’il est possible dans une vision collective renforcée. Le retour géographique pourrait faire place, par décision des Etats Membres de l’ESA, à un “juste retour”, c’est-à-dire que les entreprises sélectionnées devront répondre à des critères minima de compétitivité. La concurrence entre les Etats Membres européens permet toutefois de rendre les entreprises européennes plus compétitives. Une cohésion et solidarité entre l’UE, l’ESA et leurs Etats Membres.
Conclusion
Pour conclure, C. Harbulot met d’abord l’accent sur la convergence entre le concept de sécurité économique (« economic security ») tel que porté par les anglosaxons et les acteurs de la zone indopacifique qui comprend un volet offensif et la notion de guerre économique qui lui-même se développe dans l’univers anglosaxon sous le terme d’ « economic warfare » et se faisant éteint une controverse ancienne.
Il rappelle que les sanctions économiques ne sont qu’une partie visible des guerres économiques du temps de paix et qu’il faut intégrer le rapport dialectique qui existe entre les pays qui décide des sanctions et les économies des pays sanctionnés.
Il précise aussi la réalité des confrontations économiques au sein d’organisations structurées comme l’Union européenne ou l’agence spatiale européenne.
Enfin il ouvre quatre pistes de réflexion pour approfondir le concept
- La différenciation des ordres de grandeur entre économie de guerre, guerre économique du temps de guerre et guerre économique du temps de paix.
- La différenciation des mécanismes de rapports de force entre la vision du marché et le développement des territoires.
- La mutation des rapports de force économiques (monde matériel et monde immatériel).
- La nécessaire émulation des milieux concernés par cette problématique. (sortir des approches restrictives des opérateurs privés ou des institutions étatiques souvent enfermées dans une approche purement défensive de la sécurité économique).
Le CR451 remercie Lorraine de Juvigny pour son aide.