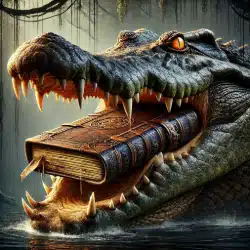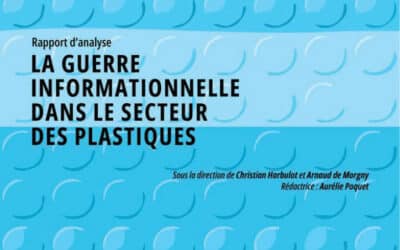Etude du cheminement d’une création de concepts
La fusion de savoir-faire à travers la formulation du concept de guerre économique


La fusion de l’approche militaire et de l’approche civile s’est concrétisée à travers la rencontre avec le général Pichot Duclos qui venait de terminer son temps de commandement à la tête de l’Ecole Interarmées du Renseignement et des Etudes linguistiques. Ce dernier avait repris l’expression « culture du renseignement » dans un article qu’il publia dans la Revue de Défense Nationale. Il avait lu mon ouvrage « Il nous faut des espions » et partageait l’approche par analyse comparée des cultures du renseignement en complétant le cadre d’analyse anglo-saxon Humint/Osint/ Sigint/ Imint[1]

Cet échange préliminaire fut suivi par un processus de « fusion culturelle » à travers les travaux qui ont été mené au sein du département Intelco de COGEPAG qui a pris ensuite le nom de Défense Conseil International dont nous avons assuré tous les deux la codirection. Cette rencontre a été fructueuse et ouvert la voie à une réflexion approfondie sur les trois objectifs de recherche suivants :
- L’analyse comparée des dynamiques de puissance économique à partir de leurs spécificités contextuelles.
- La mise en exergue de la culture informationnelle des pays étudiés.
- La complémentarité des sources fermées et des sources ouvertes dans l’acquisition du renseignement économique.
Mais le point le plus important de cette convergence de vues a été l’interprétation des pratiques liées à l’usage offensif de l’information[2] dans la mise en œuvre des politiques de puissance. C’était là l’innovation la plus importante dans la mesure où commençait à être défriché le terrain masqué, oblitéré ou omis de l’Histoire économique officielle qui allait me mener plus tard à la formulation du concept d’accroissement de puissance par l’économie.
La créativité de notre démarche commune s’est exprimée en plusieurs étapes de réflexion et de concertation avec d’autres acteurs du milieu qui s’est constitué au cours de la réalisation du rapport Martre.
- La première étape a été l’intégration du cycle du renseignement (expression des besoins/collecte/analyse/diffusion) dans la définition de l’intelligence économique qui figure dans le rapport Martre[3]. A l’époque, il n’était pas évident de faire passer dans le langage administratif un des principes méthodiques de base du monde du renseignement. L’enjeu du renseignement dans la guerre économique nous a amenés à rédiger plusieurs articles de cadrage :
- Christian Harbulot et Jean Pichot-Duclos, « L’émergence d’un nouveau type de renseignement : le renseignement de sécurité économique », revue Enjeux Atlantiques, premier trimestre 1995.
- Christian Harbulot, « Le renseignement, levier de l’économie japonaise », revue Enjeux Atlantiques, premier trimestre 1995. 70.
- Christian Harbulot, Jean Pichot-Duclos et Rémi Kauffer, « La République et le renseignement », revue de Défense Nationale, mai 1996.
- Christian Harbulot, « Une approche française de l’intelligence économique » dans l’ouvrage collectif de l’Amiral Lacoste sur La culture française du renseignement, Economica, 1998.
- La seconde étape a consisté une grille d’analyse[4] sur la nature des affrontements économiques. Cette étape a été cruciale car elle a fait ressortir les clivages entre les créateurs du concept d’intelligence économique pour qui il était fondamental de prendre en compte l’ensemble des modes d’affrontement et les représentants académiques des sciences de gestion ainsi que des économistes libéraux qui se limitaient à l’analyse concurrentielle classique.
- La troisième étape a été un élargissement du champ des problématiques concernées par l’intelligence économique (le développement des territoires dans un cadre de confrontation des économies nationales, les effets de la société de l’information sur l’évolution des méthodes offensives d’expansionnisme économique, la montée en puissance de la société civile dans les confrontations avec les entreprises).
- La quatrième étape porte la nécessité de construire une culture du combat économique articulée autour de la pratique du renseignement économique, de l’intelligence économique, de l’influence et de la guerre de l’information.
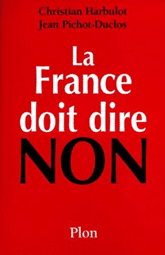
Extrait de l’ouvrage la France doit dire non[5] :
« Si nous avons pu réussir c’est parce que nous avons aussi rencontré partout des acteurs convaincus et désintéressés qui comprirent notre combat et le soutinrent chacun où il le pouvait. Au sein du ministère de la Défense, des officiers généraux et supérieurs firent prendre certaines décisions favorables, en particulier en matière de renfort d’appelés. L’IHEDN nous ouvrit ses tribunes. Au ministère de l’Industrie, la DAR-PMI nous fit jouer en région un rôle déterminant dans la mise au point d’un management de l’information destiné aux petites entreprises. D’une manière générale le réseau des Officiers de Réserve accueillit avec ouverture d’esprit et dynamisme nos idées sur la nécessité de créer un esprit de connivence entre acteurs publics et privés, adapté aux enjeux concurrentiels de la mondialisation des échanges.
Mais les principales victoires d’Intelco furent la réalisation de ses objectifs initiaux. Le premier objectif était à priori le plus difficile à atteindre compte tenu du passé. Néanmoins, il existe aujourd’hui une culture écrite en langue française sur l’usage de l’information et du renseignement dans le développement d’une entreprise ou d’un Etat. N’oublions pas que nous partions de très loin. A la fin des années 80, deux mille ouvrages étaient déjà parus aux Etats-Unis sur le Business Intelligence, le Competitive Intelligence ou le Marketing Intelligence contre moins d’une vingtaine en France sur la veille technologique ou l’espionnage industriel. Ce déficit de culture écrite était d’autant plus inquiétant qu’il passait complètement inaperçu aussi bien dans l’administration et l’université que dans le monde des entreprises.
Les multiples ouvrages qui paraissent aujourd’hui en langue française sont loin d’être une pâle copie des ouvrages anglo-saxons. L’innovation française porte sur un point décisif du débat : l’apport des cultures nationales dans les pratiques de guerre économique. Alors que la littérature américaine a développé une approche monoculturelle des rapports de force concurrentiels, fortement influencée par les pratiques des firmes multinationales à dominante anglo-saxonne, certains auteurs français ont élargi le champ de vision en faisant une étude comparative des pratiques des principales économies de marché.
Dans un premier temps, les experts américains ont nié l’importance des particularismes culturels dans les affrontements économiques. Leur thèse était simple : l’entreprise devait satisfaire le client et que le meilleur gagne dans cette compétition mondiale. Cette théorie ne résista pas longtemps à l’évidence des faits. Pour sauver l’industrie privée de l’automobile devant la pénétration du marché intérieur par les concurrents étrangers, c’est l’ensemble des acteurs économiques américains (entreprises, syndicats, autorité fédérale) qui se sont mobilisés. L’ultralibéralisme se transformait brutalement en libéralisme patriotique. Les déclarations de Bill Clinton sur la défense des intérêts économiques américains ont enfoncé le clou. Les experts américains durent nuancer leur point de vue tout en continuant à prôner une culture unique de l’intelligence économique au niveau mondial. Si cette polémique rampante n’enregistre qu’un très faible écho sur le plan international, elle ne passe pas inaperçue dans la mesure où elle prend à revers la propagande politiquement correcte des grandes institutions internationales sous influence anglo-saxonne.
Le second objectif d’Intelco était la création d’une école de spécialistes. Il fut atteint au bout de cinq ans puisque nous avons lancé en octobre 1997, une Ecole de guerre économique en partenariat avec l’école de commerce ESLSCA. Cette démarche a été possible grâce au soutien de notre réseau d’experts et à la motivation des nouveaux venus comme Benoit de Saint Sernin et bien d’autres. Le choix de l’intitulé de cette formation reposait sur une évidence : il faut un quart d’heure pour expliquer ce qu’est l’intelligence économique et une seconde pour définir la guerre économique. En effet, les entreprises qui sont attaquées par la concurrence savent instantanément quel est le coût humain et financier des défaites commerciales. En revanche, l’utilité de l’information dans le développement d’une entreprise reste encore un sujet assez abstrait pour la majorité des décideurs.
La gestion des rapports de force entre les entreprises est un sujet sur lequel il existe très peu de formations spécialisées. C’est la raison d’être de l’Ecole de guerre économique. Ses principes fondateurs résument la démarche :
– avoir un esprit combatif,
– avoir du recul par rapport à l’information,
– apprendre à travailler en équipe,
– maîtriser la prise de risque,
– apprendre la ruse.
Ces cinq principes correspondent aux cinq maux qui freinent la société française dans son entrée dans la société de l’information. La combativité des acteurs économiques est surtout individuelle : le profil de carrière passe avant l’intérêt collectif de l’entreprise. L’information est dans le meilleur des cas un art du système D et rarement une pratique professionnelle où la notion de partage apparaît comme le principal critère d’efficience et de rentabilité. L’union des forces reste un vœu pieux dans la culture de nos entreprises. Quant à la prise de risque et l’esprit de ruse, ce sont des expressions presque devenues vides de sens.
Ce qui n’est pas le cas dans les économies de combat. Identifier les attaques de la concurrence ou les techniques d’encerclement de marché sont désormais des impératifs incontournables pour la plupart des entreprises qui sont confrontées à la mondialisation des échanges. L’approche du marché par les seuls produits ne permet pas de cerner tous les facteurs de déstabilisation que ses concurrents ou d’autres forces hostiles peuvent exercer sur une entreprise. Le lancement de l’EGE constitue une première réponse à ce type d’interrogations. »