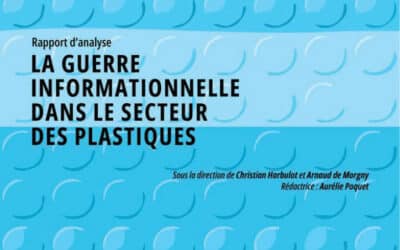Auteur: Giuseppe Gagliano président du Centre d’études stratégiques Carlo De Cristoforis (Centro Studi Strategici Carlo De Cristoforis) en Italie
Le concept de guerre économique selon Christian Harbulot
Christian Harbulot, directeur de l’École de Guerre Économique de Paris (École de Guerre Économique, EGE), définit la guerre économique comme « l’expression maximale des rapports de force non militaires ». En d’autres termes, il est possible de faire la guerre sans armes conventionnelles, en utilisant des leviers économiques, financiers et informationnels pour obtenir des avantages stratégiques. Les facteurs déclencheurs de ce conflit « sui generis » résident dans la survie d’un peuple et l’accroissement de la puissance d’un État. Harbulot souligne que la guerre économique plonge ses racines dans l’histoire de l’humanité : depuis toujours, les sociétés s’affrontent pour le contrôle des ressources et des richesses. Comme il l’écrit lui-même, « l’histoire de l’humanité est fondée sur la recherche des moyens de se développer, et le recours à la force, soit pour s’emparer des richesses et des moyens de subsistance des zones géographiques convoitées, soit pour se protéger des actes prédateurs des envahisseurs ».
Cette vision reconnaît ainsi une continuité historique entre les conflits armés et les conflits économiques : les luttes pour le pouvoir ont souvent des motivations économiques, même si elles sont masquées par des prétextes religieux ou idéologiques. Harbulot observe qu’à partir du XIXe siècle, avec le triomphe du libéralisme et des marchés ouverts, le débat sur la guerre économique a longtemps été nié ou sous-estimé, dans la conviction optimiste que le libre-échange garantirait la paix. Cependant, la compétition pour les ressources, la technologie et les marchés n’a pas disparu : elle a simplement trouvé de nouveaux moyens et de nouveaux terrains d’action dans la modernité. Le politologue américain Edward Luttwak parlait déjà en 1990 d’une « logique de conflit exprimée avec la grammaire du commerce », inventant le terme de géo-économie. Dans ce paradigme, les outils économiques (droits de douane, investissements, sanctions, contrôle des technologies, etc.) deviennent des armes pour promouvoir les intérêts nationaux et influencer les équilibres géopolitiques.
Pour Harbulot, la guerre économique est donc une composante structurelle des stratégies géopolitiques actuelles. Les États redeviennent des acteurs stratégiques centraux : même dans un monde globalisé, ils protègent leurs informations sensibles, soutiennent leurs entreprises nationales et orientent le développement technologique selon l’intérêt national. Par exemple, les investissements publics dans des secteurs clés ou le soutien aux champions industriels nationaux peuvent être interprétés comme des mouvements défensifs et offensifs sur un « champ de bataille » économique. De la même manière, des pratiques comme l’espionnage industriel, les cyberattaques contre des infrastructures économiques ou le contrôle des matières premières stratégiques s’inscrivent dans la logique de la guerre économique, car elles visent à affaiblir la puissance d’autrui ou à préserver la sienne. En résumé, la guerre économique selon Harbulot est la continuation de la compétition globale par d’autres moyens (économiques, financiers, informationnels), avec pour objectif d’accroître son pouvoir relatif et de garantir la sécurité et la prospérité nationale sans recourir, autant que possible, à un affrontement militaire direct.
Les droits de douane américains contre l’UE comme acte de guerre économique
Dans le cadre théorique de Harbulot, même les politiques commerciales agressives – comme l’imposition de droits de douane – peuvent être considérées comme des actes de guerre économique. Un exemple emblématique est la longue dispute entre Airbus et Boeing dans le secteur aéronautique : des décennies de compétition et d’accusations mutuelles de subventions déloyales, qui ont culminé avec l’imposition de droits de douane américains sur des produits européens suite à la décision de l’OMC dans l’affaire Airbus. Des analystes formés à l’EGE ont qualifié cette lutte de véritable « guerre économique de cent ans » entre l’Europe et les États-Unis dans le secteur aérospatial. Il s’agit en effet de mesures de rétorsion par lesquelles Washington a frappé des produits symboles de l’UE (des avions civils aux fromages et vins européens) pour contraindre Bruxelles à respecter les règles du jeu imposées par les USA et protéger ses propres industries.
Les droits de douane sur l’acier et l’aluminium introduits par les États-Unis en 2018 (25 % sur l’acier et 10 % sur l’aluminium importés, touchant également les alliés européens) ont été perçus en Europe non seulement comme du protectionnisme économique, mais comme une attaque stratégique. L’ancien président Donald Trump avait même menacé d’imposer des tarifs de 25 % sur les automobiles européennes, accusant l’UE d’avoir « escroqué » les États-Unis dans le domaine commercial. Ce type de pression commerciale vise à plier les contreparties : en termes harbulotiens, cela équivaut à utiliser le levier économique national (le marché américain, essentiel pour les exportations de l’UE) comme une arme de coercition pour obtenir des concessions politiques ou économiques. Il n’est pas surprenant que, face aux droits de douane de Trump, l’UE ait réagi avec des contre-droits sur des produits américains emblématiques (motocyclettes, bourbon, jeans), dans ce qui fut immédiatement qualifié de « guerre des droits de douane » transatlantique.
Il convient de souligner que les initiatives de guerre économique des États-Unis contre l’Europe n’ont pas débuté avec Trump. Des études italiennes d’intelligence économique soulignent qu’un accroissement des droits de douane envers l’Europe avait déjà eu lieu sous l’administration Obama. De plus, les États-Unis appliquent depuis longtemps des mesures de coercition économique indirecte : par exemple, des sanctions unilatérales et des embargos (qui pénalisent les entreprises européennes opérant dans des pays considérés comme « ennemis » des USA) ou l’application extraterritoriale des lois américaines – pensons aux amendes colossales infligées à des banques européennes pour avoir violé des sanctions américaines, ou à l’interdiction pour les entreprises de l’UE de faire des affaires avec l’Iran après le retrait des États-Unis de l’accord sur le nucléaire. Ces pratiques influencent le marché mondial autant, sinon plus, que les droits de douane traditionnels, et elles s’inscrivent également dans les outils de la guerre économique selon la doctrine de Harbulot. En résumé, les droits de douane imposés par les États-Unis à l’Union européenne – que ce soit dans le cadre de différends commerciaux spécifiques ou comme partie d’une stratégie protectionniste plus large – peuvent être interprétés comme des actions hostiles sur le plan économique, visant à affaiblir la compétitivité européenne ou à contraindre l’UE à négocier dans des termes favorables à Washington. C’est le reflet concret de ce rapport de force non militaire dont parle Harbulot : l’économie devient le champ de bataille où deux alliés se découvrent concurrents sur ce terrain.
La clairvoyance de Harbulot et la compétition entre blocs économiques
Les réflexions de Harbulot sur la guerre économique se sont révélées prophétiques à la lumière des événements des dernières années. Il avait mis en garde l’Europe contre une pensée purement idéaliste ou une vision de la « fin de l’histoire » économique : le monde post-Guerre froide, malgré l’apparent triomphe du libre marché mondial, voit resurgir des rivalités entre grandes puissances sous de nouvelles formes. Aujourd’hui, la compétition entre blocs économiques est évidente pour tous. D’un côté, il y a le défi USA-Chine, une lutte pour la suprématie technologique et commerciale qui a pris les traits d’une guerre économique tous azimuts (des droits de douane croisés entre Washington et Pékin au découplage technologique sur les puces et la 5G, en passant par le contrôle des terres rares et des chaînes d’approvisionnement stratégiques). De l’autre, l’Europe se retrouve coincée entre ces deux géants et peine à se tailler un rôle autonome. Harbulot avait décrit un scénario où, avec la disparition de l’opposition idéologique de la Guerre froide, même les alliés transatlantiques deviennent des concurrents économiques. C’est exactement ce qui s’est produit : les États-Unis, libérés de l’obligation de défendre « gratuitement » l’Europe contre une menace soviétique, ont poursuivi sans scrupule leurs intérêts nationaux, même au détriment des Européens (pensons, au-delà des droits de douane, au Buy American Act ou aux récentes politiques d’incitation de l’Inflation Reduction Act, perçues par l’UE comme discriminatoires envers les entreprises européennes).
Harbulot mettait aussi en évidence la faiblesse structurelle de l’Europe en termes de culture du pouvoir et d’intelligence économique. Les élites européennes – contrairement à celles des États-Unis, de la Chine ou de la Russie – ont longtemps sous-estimé la dimension conflictuelle de l’économie, adoptant l’idéologie du libre marché comme un terrain « neutre ». Ce manque de réalisme stratégique rendait, et rend encore, l’Europe vulnérable : Harbulot avertissait que, sans prise de conscience, l’UE resterait « une annexe des États-Unis » ou un vase d’argile parmi des vases de fer (comme la Chine, la Russie ou les puissances pétrolières). Aujourd’hui, avec des crises comme la guerre en Ukraine et les tensions USA-Chine, nous voyons une Europe souvent en difficulté : dépendante des États-Unis pour la sécurité militaire et le soutien en Ukraine, dépendante de la Chine pour les approvisionnements industriels et le marché d’exportation, et vulnérable sur le front énergétique (comme l’a montré la crise du gaz liée au conflit russe). Tous ces éléments confirment la clairvoyance de l’analyse de Harbulot : l’économie est devenue un terrain d’affrontement explicite entre blocs, et l’Europe risque l’irrélevance si elle n’apprend pas à jouer le jeu du pouvoir.
Cela dit, certains développements récents indiquent que l’Europe commence, bien que lentement, à s’équiper. Depuis les années 1990, Harbulot insistait sur l’importance de se doter d’une intelligence économique et d’une stratégie nationale (ou continentale) pour protéger son système économique. Aujourd’hui, des concepts similaires émergent dans le discours de l’UE sous des termes comme « autonomie stratégique » ou « souveraineté technologique ». L’Union a mis en place des mécanismes de filtrage des investissements étrangers pour empêcher les acquisitions hostiles dans des secteurs sensibles (une mesure impensable il y a quelques années dans des pays libéraux comme l’Allemagne). Elle est également en train de développer un « instrument anti-coercition » pour se défendre ou riposter face aux pressions économiques externes (par exemple, les menaces de boycott ou d’embargo de la part de grandes puissances). En substance, il s’agit de commencer à reconnaître le jeu de la guerre économique et de se doter de contre-mesures, confirmant implicitement les diagnostics de Harbulot sur la nécessité de penser en termes de pouvoir.
Harbulot avait même envisagé des hypothèses de nouvelles alliances mondiales comme une issue à l’étau des blocs existants. Dans une interview de 2018, il évoquait un possible espace d’indépendance stratégique fondé sur un accord « ni européen ni atlantique, mais latin ». Cette suggestion – une alliance entre pays de culture latine – pourrait faire penser à une coopération renforcée entre certaines nations d’Europe du Sud (France, Italie, Espagne) et peut-être le monde latino-américain, pour contrebalancer le duopole USA-Chine. Au-delà de la faisabilité d’un tel scénario, cette idée révèle une volonté d’imaginer des architectures alternatives sur l’échiquier mondial, signe de l’importance que Harbulot accorde à la recherche d’espaces de manœuvre autonomes pour échapper à la subordination économique.
Scénarios futurs pour l’Europe et possibles contre-mesures
En regardant vers l’avenir, l’Europe se trouve à un carrefour stratégique. Un scénario possible est que l’UE reste passive, subissant les événements : dans ce cas, elle continuera d’être un terrain d’affrontement pour les autres ou un « terrain de chasse » pour les puissances économiques extérieures. Cela signifierait une dépendance technologique (microprocesseurs américains ou asiatiques, plateformes numériques américaines, infrastructures 5G chinoises), une exposition à des chantages économiques (comme la coupure des approvisionnements énergétiques ou les sanctions secondaires des États-Unis) et une perte de compétitivité de ses secteurs industriels stratégiques. Dans ce scénario pessimiste, l’Europe risque de glisser vers une irrelevance géopolitique, réalisant la métaphore du vase d’argile de Harbulot. Elle pourrait être contrainte de s’aligner tour à tour sur l’un des blocs dominants (probablement les États-Unis, compte tenu des liens avec l’OTAN et des valeurs communes), mais toujours en position de subalterne et avec des marges de négociation réduites.
L’autre scénario est celui d’une Europe qui prend en main son destin économique et stratégique. Cela impliquerait d’adopter enfin bon nombre des recettes implicites dans les théories de Harbulot : développer une unité d’intention entre les pays européens sur le front de la politique économique extérieure, en surmontant les divisions internes lorsqu’il s’agit d’affronter des concurrents externes ; renforcer les outils de défense commerciale (droits antidumping, sanctions contre les pratiques déloyales, contrôle des exportations de technologies critiques) ; investir massivement dans des secteurs clés pour réduire les dépendances (de l’énergie aux batteries électriques, des semi-conducteurs à l’intelligence artificielle, peut-être en coordonnant des projets européens sur le modèle d’Airbus) ; et promouvoir une culture partagée de l’intelligence économique. Ce dernier point signifie à la fois mieux protéger les secrets industriels et les informations sensibles européennes, et collecter des données sur le comportement économique des rivaux pour anticiper leurs mouvements – exactement le type de formation dispensé par l’École de Guerre Économique de Harbulot.
Une Europe plus consciente pourrait également élaborer des stratégies offensives sur le plan géo-économique. Par exemple, exploiter le poids de son marché unique (le plus grand au monde) comme levier de négociation : par le passé, Bruxelles a déjà imposé des normes réglementaires mondiales (« effet Bruxelles ») et a su utiliser des sanctions économiques (contre la Russie) avec un impact notable. À l’avenir, elle pourrait employer des mesures de rétorsion ciblées contre ceux qui la frappent économiquement, se faisant respecter à la table des négociations. Elle pourrait aussi diversifier ses alliances : en plus de maintenir le partenariat transatlantique, l’UE pourrait tisser des liens commerciaux et technologiques plus étroits avec des pays proches (comme le Japon, l’Inde, les démocraties asiatiques, certaines puissances moyennes), créant un réseau de collaboration qui diluerait sa dépendance aux pôles USA-Chine. Dans un scénario d’ordre multipolaire, l’Europe aurait intérêt à ne pas s’isoler ni à s’aligner aveuglément, mais à devenir un « troisième pilier » autonome qui dialogue avec tous, selon ses propres intérêts.
Naturellement, réaliser ce scénario exige une volonté politique et une capacité de vision à long terme. Cela signifie aussi accepter certains coûts à court terme (par exemple, investir dans la résilience peut être coûteux, tout comme diversifier les approvisionnements ou produire localement des biens auparavant importés à bas prix). Mais la leçon de Harbulot est que le prix de la naïveté peut être bien plus élevé : perdre des parts de marché, céder des actifs stratégiques ou dépendre des technologies d’autrui équivaut à affaiblir sa propre sécurité nationale. En définitive, l’Europe de demain devra choisir si elle veut être sujet ou objet de la guerre économique mondiale. Adopter une vision lucide et « réaliste » à la manière de Harbulot – sans renoncer à ses valeurs, mais sans ignorer les rapports de force – pourrait lui permettre de naviguer dans la compétition croissante entre blocs économiques avec plus d’autonomie et de succès. Comme le note Giuseppe Gagliano (un chercheur italien disciple de Harbulot), ce n’est qu’en retrouvant la conscience du concept de pouvoir que l’Europe pourra éviter de rester un simple spectateur et redevenir un protagoniste sur la scène internationale.
Conclusion
Les théories de Christian Harbulot, développées il y a des décennies, offrent aujourd’hui une clé de lecture précieuse pour comprendre des dynamiques apparemment déconnectées – des droits de douane USA contre l’UE à la course aux microprocesseurs, en passant par la « guerre des sanctions » entre l’Occident et la Russie. Tous ces phénomènes font partie d’une guerre économique mondiale, larvée mais de plus en plus évidente. Pour l’Europe, en tirer profit signifie se doter des outils analytiques et opérationnels pour défendre ses intérêts dans un monde où la compétition économique est totale. Le débat n’est plus académique : il concerne les emplois, le bien-être des citoyens et la capacité des démocraties européennes à préserver leur modèle dans un contexte bien plus rude que celui imaginé dans les années post-rideau de fer. Harbulot nous rappelle, en somme, que la géopolitique du XXIe siècle se joue autant avec les droits de douane et les multinationales qu’avec les chars d’assaut, et que seuls ceux qui sauront manœuvrer avec astuce sur ces deux plans pourront se dire véritablement souverains.